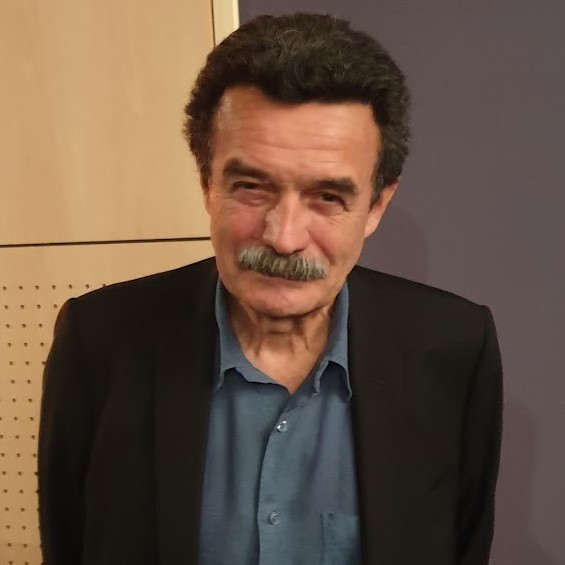D’où sort-il ton macchabée ? interroge le rédacteur en chef.
Fred n’en sait fichtre rien. Les crimes obéissent à des lois étranges. On avait retrouvé le corps d’une jeune femme dans un étang, à vingt kilomètres de toute habitation. Aucune trace de pneus sur le chemin. Aucune brindille sur le lieu du meurtre. C’est à croire que la victime s’était étranglée toute seule avant de se jeter dans les eaux verdâtres de l’étang. Le mystère était total. Une catastrophe sur le plan journalistique.
C’est une histoire à dormir debout, braille encore Albert Duponcif. Si vous aviez un peu d’imagination, ce fait divers pourrait alimenter nos colonnes pendant quelques jours. Il faut trouver des indices. Interroger les proches de la victime. D’après le médecin légiste, la jeune femme n’avait pas d’eau dans les poumons. Elle était déjà morte avant la noyade. Réfléchissez un peu. Un cadavre ne peut pas tomber du ciel !
- Pourquoi pas ? reprit avec impertinence le journaliste. Il a très bien pu être largué par un hélicoptère. Un dirigeable peut-être. Fred avait l’habitude des coups de gueule. En été, il ne se passait rien en dehors des fêtes villageoises et des manifestations sportives. On lui mettait la pression. C’est à lui qu’incombait de combler l’absence d’événements politiques marquants. On lui demandait de transformer la réalité en fiction. D’écrire un feuilleton à partir de la noirceur du réel. Du sordide. Il refusait. Il était intègre. La vérité lui importait plus que tout. Il se tut. Il remit sa veste en jean, réajusta ses lunettes cerclées de bleu et quitta le bureau en me faisant un clin d’œil.
C’était à mon tour d’entrer.
- Vos critiques dépassent les bornes, Angela… Le gérant du Palace a encore téléphoné. Pas une ligne positive sur Manon des sources. Je lis : les haillons de berger tombent aussi bien sur le corps de Daniel Auteuil que le dernier Wunderbra sur les seins de ma tante. Je vous ai fait confiance, l’article n’a pas été relu au moment du bouclage. Vous n’êtes pas sans savoir que notre journal a des accords publicitaires avec le Palace. Votre rôle est d’inciter le public à fréquenter les salles obscures. Pas le contraire. Je vous laisse une dernière chance. Vous écrirez sous un pseudonyme. Votre signature doit disparaître au plus tôt. Notre journal informe les spectateurs sans prendre position. Entendu ?
La critique cinématographique, j’aimais çà. Écrire sur les films me permettait de me fondre dans la foule anonyme des salles de cinéma. De fuir la réalité comme on fuit la douleur. De m’approcher du rêve. D’être en état d’apesanteur. C’était une sorte de vie parallèle.
L’idée de voir disparaître ma signature m’excitait au plus haut point. J’allais devenir quelqu’un d’autre. Outre l’avantage de détourner l’attention du rédacteur en chef, j’avais la chance de réapparaître dans la peau d’une femme imaginaire. Quelqu’un qui serait mon double sans pour autant me ressembler.
Le premier pseudonyme qui me vint à l’esprit fut Adeline Linel. Ce nom tintait à mon oreille comme celui d’Antoine Doinel. Aussi, le répétai-je à plusieurs reprises pour me l’approprier. Adeline Linel, Adeline Linel, Adeline Linel…
Je me remis à écrire en empruntant un style nouveau. Un ton moins corrosif. Plus circonspect. Pour étrange qu’elle paraisse, cette situation me comblait. Mes amis me demandaient : Écris-tu encore ?
Je répondais évasivement que j’étais à la recherche de moi-même et que j’avais besoin de temps pour me consacrer à mon ego. La plupart d’entre eux, ex soixante-huitards, réglaient leurs infortunes conjugales sur le divan d’un psychanalyste. Je pensais être différente. Je croyais naïvement que l’écriture pût être salvatrice. Chacun chasse ses démons comme il peut.
Je découvris avec surprise mes premiers textes et ma signature à la fin d’un article consacré au cinéma français. Je fus étonnée par cette lecture. J’éprouvais le secret plaisir de l’imposture. En mentant aux autres, je me mentais à moi-même. Il me parut étrange de vivre sous une autre identité.
Dans les salles obscures, je m’asseyais au bord de la rangée. C’était une habitude. C’est ainsi que j’entrais dans l’univers des fantômes. Le cinéma, - lieu funéraire par excellence -, se refermait au-dessus de nos têtes comme le couvercle d’un cercueil. Il m’entrainait dans ses labyrinthes secrets. Je me laissais engloutir dans la nuit tiède où les spectateurs se rassemblent aux pires moments de désenchantement pour ne former qu’un seul corps, qu’une seule respiration.
Adeline Linel prenait ma place. Elle était une autre. Son nom me protégeait. Elle s’appliquait à parler le plus sérieusement de cet art qui se prête à toutes les interprétations. Elle écrivit : Déroutant comme un paysage dans le brouillard, Identification d’une femme, laisse le spectateur sur le bord de la route. Il y eut encore une centaine de lignes sur l’impossible rencontre entre l’homme et la femme. Sur la scène d’amour la plus aérienne du cinéma contemporain. Sur le mystère du cosmos. Indéchiffrable comme l’amour.
Parfois Adeline Linel prêtait ses propres sentiments à ses personnages. Personne ne pouvait le lui reprocher puisque le cinéma s’ouvrait sur cette possibilité.
Je me rendais chaque jour au cinéma. Je prenais des notes sur mon carnet à spirale en évitant de froisser les feuilles. Je ne voulais pas importuner les spectateurs. Je côtoyais les rôdeurs de l’ombre qui trouvaient dans le rituel du cinéma un exutoire. Monomanes confus. Collectionneurs d’autographes. J’étais comme eux. Enfouie dans la nuit. Invisible. Le mobile est le même pour tout le monde. Nous sommes dans l’obsession du cinéma comme d’autres dans l’obsession de la vie. Pour d’obscures raisons, nous préférons la pénombre ; lieu secret de tous les fantasmes. Nous préférons oublier la réalité pour le rêve. A la clarté des choses, nous préférons la nuit interlope.
Adeline Linel entra dans le bar Le Septième art. Elle sorti son carnet pour écrire : Wenders se surpasse, Les Ailes du désir est son meilleur film. Approche facile, pensai-je, au regard d’une aussi grande richesse. Existe-t-il une mémoire objective des images ? Et pourquoi vouloir classer les films plutôt que de parler de la mémoire poétique entre les anges et les humains, de l’impossible incarnation de ce désir-là. De la beauté du noir et du blanc. De la caméra au-dessus de Berlin à l’époque des deux Allemagnes. Être critique, c’est sentir le mouvement du monde et celui du cinéma. C’est du moins ce que je croyais.
Je passais de temps en temps au journal. Fred n’avait pas réussi à élucider le fait divers. Le cadavre avait refait surface au milieu des nénuphars. Il n’y avait rien d’autre à ajouter. Le mari de la victime était un garagiste sérieux. Le couple sans histoire. L’enquête piétinait. Le temps finit toujours par avoir raison du sordide. Les cadavres disparaissent de la mémoire comme le sang séché. Les corps imprégnés de mousse pourrissent quelques jours à la morgue. Puis on les enterre. L’assistance est nombreuse. Ce jour-là il pleut. Enfin, presque toujours. Des parapluies noirs et gris autour d’un cercueil. On voit cette scène-là dans les films. Cela ajoute un peu de pathos.
Fred n’avait rien de particulier à dire. Il attendait qu’un autre drame occupât les esprits. Un incendie criminel ou une simple noyade avant l’arrivée des secours. En principe, tout corps plongé dans l’eau glacée ne remonte pas à la surface ; c’est ainsi. La vie d’un homme se résume à peu de choses. Un titre en caractères gras. Un papier d’une quarantaine de lignes. Fred le savait. Il vivait sans prendre de risques. Il ne voulait pas attirer la grande faucheuse. Je le croisais quelquefois. Il me regardait avec une certaine malice comme si nous faisions la comptabilité des morts. Les siens aux prises avec un destin féroce. Les miens immuablement assis dans l’obscurité dans l’attente d’une petite lueur de bonheur. D’un événement qui changerait la face des choses. D’un rebondissement. D’un indice. Et du baiser final. Cela doit forcément arriver un jour. Dans la vie aussi.
En me rendant au cinéma, je croisais les paumés en quête d’incandescence. Léon F. ne travaillait pas le mercredi. Ce jour-là, il avançait à tâtons dans l’univers clos des salles obscures. Je savais où le trouver. Je m’asseyais au cinquième rang juste à côté de lui. Il se tournait vers moi et me tendait sa petite boite de cachous Lajaunie. Sans ce rituel compulsif, nous nous sentions perdus. Nous partions ensuite vers des aurores boréales et des forêts épaisses où nous aimions disparaître.
A la sortie, il nous arrivait de croiser René H. Il circulait à bicyclette d’un cinéma à l’autre pour ne pas perdre de temps. C’était notre adversaire. Il nous fallait à tout prix éviter qu’il soit le premier à découvrir les films. Notre honneur de cinéphile était en jeu. S’il avait pu pénétrer dans la salle sans descendre de son vélo, il l’eût volontiers fait. Les jours de pluie, il protégeait son jeans avec des pinces à vélo. Enfin, en début de soirée, nous croisions Michel G. Toute la journée il s’ennuyait dans le bureau où il remplissait des formulaires qu’il classait dans des pochettes de couleurs différentes. A la sortie du travail, il ne prenait pas le temps de rentrer chez lui. Il se précipitait vers le cinéma le plus proche pour ajouter un titre de plus à sa liste de l’année. Nous avions quelques heures d’avance sur ce rival et il nous importait de ne pas les perdre. Léo S. était obèse. Chaque jour il se gavait de Nutella ; il voulait éviter de perdre du temps à cuisiner afin de rejoindre au plus vite l’objet de sa passion. Ensuite il prenait une douche. Il voulait que la séance soit une expérience parfaite. A la fin de ses ablutions, il avalait un comprimé contre les raideurs articulaires. Dans la poche intérieure de son blouson, il glissait quelques médicaments de première nécessité : des comprimés contre les douleurs d’estomac, des pastilles contre la toux, du collyre contre les picotements oculaires. Il palpait une dernière fois ses poches pour voir s’il n’avait rien oublié. Il habitait à cent mètres des cinémas et préférait arriver en avance. Il voulait choisir sa place. S’installer au fond de la salle pour avoir une vue dégagée. Être le plus loin possible des autres spectateurs. Éviter les désagréments d’une odeur ou d’une réaction inappropriée. A la dernière minute, il nettoyait ses lunettes. Rien ne devait le gêner, lui ôter une once de ce plaisir auquel il consacrait toute sa vie.
Pour chacun d’entre eux, d’entre nous, le cinéma répondait à un profond besoin de consolation. Je les rejoignais et m’installais toujours dans le premier tiers de la salle, plus précisément au cinquième rang. Chaque semaine était la répétition des mêmes gestes aux mêmes horaires comme si nous avions fini par devenir invisibles ou exclus du monde réel des humains. Nous étions des ombres. Des formes silencieuses. Des corps hybrides enchaînés les uns aux autres par le lien obsédant de l’obscurité.
Je me sentais mieux. Mon pseudonyme me protégeait. Écrire devenait facile. Critiquer était un jeu auquel je me prêtais avec légèreté. Je retrouvais une tranquillité d’esprit. Une vie sans conflit. Plus terne. Moins passionnée. Mes articles paraissaient chaque semaine à côté des encarts publicitaires de Palace. Je redécouvrais le temps de vivre. De flâner entre les séances.
Je n’attachais jusqu’alors assez peu d’importance à mon apparence physique. Ce n’était pas une priorité. Je comptais sur ma verve décapante pour me faire remarquer. J’étais une jeune fille rangée qui prenait sa revanche avec les mots. J’étais sérieuse. La trentaine. Célibataire. Plutôt timide.
Je décidai de changer de tête et de me rendre chez mon coiffeur.
- Elle les veut comment ? demanda-t-il
- Très courts, répondis-je. Très courts et blond platiné.
En quelques coups de ciseaux, mon visage prit une forme plus arrondie. La couleur blonde me fit un drôle d’effet. J’étais méconnaissable.
Mon ensemble beige tranchait un peu avec ma nouvelle coiffure. Il me fallait changer de style. Faire les boutiques ne faisait pas non plus partie de mes habitudes Je m’y résolus pourtant. J’entrai dans les cabines pour essayer des jupes de toutes les couleurs, des robes à pois ou à grands ramages exotiques. Désormais rien ne me dérangeait. Je demandais un avis aux vendeuses sans en tenir compte. Je découvrais le plaisir du travestissement qui dépasse le fait de se vêtir. J’essayais des chapeaux. Des robes noires en satin avec des décolletés pigeonnants. Je me surprenais à toutes les audaces auxquelles les femmes sont familières à l’âge d’aimer. Je jetai mon dévolu sur une robe d’un rouge éclatant.
Je me rendis au journal pour apporter un article sur le jeune cinéma britannique à l’occasion de la sortie de Distant Voices. Fred sortait du bureau du rédacteur en chef. Il me fit face sans me regarder.
- Bonjour, lui dis-je.
- Oh Angela, je ne t’ai pas reconnue. Que nous vaut cette transformation radicale ? Un amoureux peut-être…
- je t’en prie. Tu sais très bien que je n’aime pas évoquer ma vie privée.
- Pardonne-moi, je te trouve très séduisante. C’est tout…
Il prit un air gêné. Et le cinéma ? Je lis très régulièrement la chronique de ta remplaçante Adeline Linel. Son style manque singulièrement d’humour. Duponcif m’a dit que tu arrêtais momentanément d’écrire. C’est dommage pour le journal.
- Ne t’inquiète pas, je reviendrai. Et toi ?
- Moi tu sais, je passe mon temps avec des cadavres. De vrais cadavres. Toi, tu sais te protéger, le cinéma enjolive le monde.
- Si ça te plait de voir les choses sous cet angle…
Nous nous taisions. Nous avions tout dit.
Le soleil éclaboussait la rue. Adeline Linel sortait du cinéma. Elle avait perdu l’habitude de vivre en plein jour. De côtoyer la foule exaltée. Elle se fondait dans le noir du monde et se demandait pourquoi les films faisaient autant état de la tristesse. Elle arpentait les salles obscures avec un sac en bandoulière rempli de dossiers de presse. Elle voyait plusieurs films par jour. Les images se superposaient dans sa tête. Elle mélangeait les séquences. Les bandes-son s’entrecroisaient dans une cacophonie assourdissante. Savait-elle encore qui elle était ?
Fred recherchait ma compagnie. On se retrouvait à la terrasse du Tout va bien. On buvait un demi. On regardait passer les voitures. Ce n’était pas compliqué. Je lui racontais les films noirs. Je lui demandais : A ton avis, lequel des deux tue l’autre ? C’était notre jeu favori. Les mois de printemps passaient. On regardait le vol des hirondelles. On rêvait de départ ? De voyages lointains. Des paysages entrevus dans les films. On restait sur place. On aimait bien ça.
Adeline Linel poursuivait sa quête et se rendit au cinéma Les 400 coups pour une rétrospective consacrée aux films de Maurice Pialat. A nos amours est le film du soir. Sous la lumière inventée des projecteurs, l’épaule de la jeune actrice crève l’écran. Elle s’appelle Sandrine Bonnaire. Quelques images plus tard, les acteurs sont en place pour un dîner de famille. Le père (considéré comme mort dans le scénario) revient sans prévenir. Personne ne l’attend. La caméra tourne. La fiction avance toute seule. Imprévisible.
Adeline Linel retient sans souffle. Elle découvre ce film tourné en 1983. Le cinéma l’a habituée à des séquences bien ficelées. Des prises. Reprises une dizaine de fois ou plus. Des images lisses. Sans ratures. Sans accidents. Comment écrire sur cette œuvre ? Comment parler de ces acteurs hagards, piégés par la violente irruption du père interprété par le cinéaste lui-même ? Comment parler de Suzanne, admirable Sandrine Bonnaire ? Adeline s’était identifiée à la jeune fille ; elle aussi cultivait l’idée de liberté comme on cultive des fleurs rebelles. Pour le plaisir de séduire et l’oubli de la solitude. Adeline le savait ; Comme Suzanne, elle était à la recherche d’un homme qui serait plus son complice que les garçons de son âge qu’elle jugeait trop légers. Elle ne voulait pas être comme tout le monde. Elle s’enfonçait dans les films pour se connaître elle-même. Elle avait mis un certain temps pour comprendre ces choses-là. Elle avançait lentement dans la nuit comme Sandrine Bonnaire au bord de la barrière de sécurité de l’autoroute. Avec un déhanchement qui faisait penser à la démarche des stars. Comme les femmes de cinéma avancent bien au-delà de l’écran et de la limite autorisée par les rêves. Elle avançait…
Adeline Linel rejoignait peu à peu la cohorte des mal aimés. Elle s’aventurait dans les confins d’elle-même où l’imaginaire prend des formes inconnues. En s’approchant tout près du cinéma, elle s’éloignait de la vie.
Elle disparaissait dans un monde parallèle. Elle devenait l’ombre d’elle-même, un fantôme de Feuillade, la Belle de Cocteau capturée par la Bête.
Nouvelle extraite de l'ouvrage Fondus enchaînés de Michèle Tatu, éditions Aréopage, 2010.