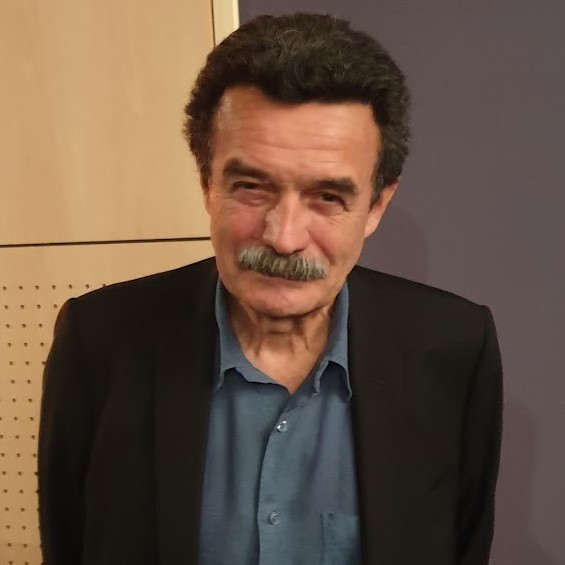Frédéric Paulin, grâce à ce que l’on sait aujourd’hui, reconstruit un puzzle. Celui de l’image d’une pieuvre, le terrorisme islamiste, étalant ses tentacules sur le monde entier, semant mort et désolation. Un sujet traité en trois volumes, entre réalité, fiction de certains personnages, réalité d'autres, géopolitique, combines et magouilles de quelques services d’État, cécité ou compromissions de responsables politiques… Mais aussi personnes clairvoyantes, engagées dans la lutte contre une nébuleuse acharnée à détruire les démocraties, et tous les pays qui ne répondent pas aux critères d’un califat dont les jihadistes, au nom de leur Dieu disent-ils, souhaitent la constitution.
Le premier roman de la trilogie de Frédéric Paulin, La guerre est une ruse, nous embarque en Algérie, pendant les 10 années sanglantes des années 90. Pour rappel, Algérie, 1992. Une poignée de généraux, les « janviéristes », ont pris le pouvoir. L’état d’urgence est déclaré, les islamistes pourchassés ont pris les armes. Le pays sombre dans une violence sans précédent… Tedj Benlazar, agent de la DGSE, suit de près les agissements du tout puissant service du renseignement militaire, le sinistre DRS qui tire toutes sortes de ficelles dans l’ombre. (Extrait de la quatrième de couverture).
La réalité du terrorisme est portée par des personnages qui ne sont pas tous de fiction
Dans Prémices de la chute, le deuxième opus, nous retrouvons les personnages essentiels de La guerre est une ruse : Tedj Benlazar, sa fille Vanessa bien impliquée dans l’histoire et dans l’Histoire. De nouveaux venus, dont un journaliste local que rien ne prédestinait à être embarqué dans ce qui est, il faut bien le dire, un conflit mondial, et qui va se trouver dans la peau du reporter de guerre, de Roubaix à l’Afghanistan…
Une femme, membre de la DGSE, Laureline Fell, amoureuse de Tedj Benlazar… Un jeune français déçu, Zacarias se prépare pour le départ pour ce qu’il croit être une guerre sainte…
Comme dans le premier roman, le texte se frotte de près avec la réalité. Ce qui en rend la lecture troublante. La réalité du terrorisme est portée par des personnages qui ne sont pas tous de fiction. Il y est, par exemple, question des moines de Tibbhirine, dont on peut encore se demander si leur décision de rester dans leur monastère n’est pas à l’image de la cécité qui a prévalu trop longtemps (aujourd’hui encore ?) sur la nature du danger qui menaçait le monde et le menace encore aujourd’hui. Si un angélisme coupable n’a pas présidé à de non décisions, atermoiements, relativisations, compromissions au nom d’intérêts douteux ? Sur la route en direction de Tibhirine, Benlazar pense qu’encore une fois le DRS a déconné, et que les meurtres des moines vont être maquillés en action du GIA. La France s’est de nouveau fait mener en bateau.
L’autre camp a quelques hommes prêts à mourir
En exergue de ce deuxième opus sur le sujet, une phrase du roman de Don DeLillo, L’homme qui tombe, un roman qui « travaille » les attentats du 11 septembre, à New-York.
Un camp a le capital, la main-d’œuvre, la technologie, les armées, les agence de renseignements, les villes, les lois, la police et les prisons.
L’autre camp a quelques hommes prêts à mourir.
Pour avoir une compréhension de comment on fabrique des hommes prêts à mourir au nom de leur Dieu, (qui n’en demande sans doute pas tant !) on peut lire ou relire le magistral roman de Vladimir Bartol, écrit en 1938, Alamut. Un roman terriblement prémonitoire qui analyse de façon lucide et cruelle, les mécanismes conjugués du terrorisme d’État et du fanatisme religieux. Tout l’imaginaire diabolique, mortifère, de la fabrication de terroristes agissant au nom de leur Dieu est déjà présent dans ce roman de la fin années 30, tel qu’on l’entend raconter dans les reportages sur Daesh, parfois par les protagonistes eux-mêmes.
La prémonition de Vladimir Bartol s’est réalisée. Hassan Ibn Saba, le « vieux de la Montagne » s’est réincarné en la personne de Ben Laden et de ses successeurs. L’hydre à mille têtes n’est pas encore anéantie, loin s’en faut.
- Mais c’est justement ce que je veux ! s’écria gaîment Hassan. M’introduire dans l’atelier d’Allah en personne et parce que l’homme est vieux et malade reprendre Son travail. Rivaliser d’adresse avec lui. Pétrir et façonner de nouveau l’argile. Et ensuite créer vraiment un homme nouveau !
[…]
- Le lien qu’il y a entre toutes ces choses est tout simple, fit en riant Hassan. Mon testament ne vise qu’à faire de vous les légataires d’une institution qui sera mon invention. La force de cette institution reposera sur des hommes d’une espèce tout à fait nouvelle. Ils se distingueront par un désir fou de la mort et un dévouement aveugle au chef suprême. Et nous n’obtiendrons d’eux ces rares vertus qu’en éveillant leur foi totale, que dis-je leur foi ! la connaissance totale des jouissances qui les attendent au paradis après leur mort !
Dans les romans de Frédéric Paulin, si ses personnages, réels ou fictifs, sont conduits à avoir une vie hors normes, ils n’en demeurent pas moins des hommes et des femmes qui aiment, qui se jalousent, qui doutent, qui essaient tant bien que mal de vivre, ou de survivre dans un contexte hostile, dans une guerre à laquelle ils ne sont pas préparés.
La guerre a commencé
Dans Prémices de la chute, de Frédéric Paulin, retour en France, en 1996.
On ne se prépare pas à la guerre.
Parfois on s’est entrainé, parfois on s’est armé, parfois on a dressé des plans d’attaque ou de défense, mais rien ne prépare à la guerre. À l’absence d’issue, à la violence totalisante, à la peur qui vous paralyse, à l’avenir qui n’est plus que hasard. Il n’y a pas de préparation à la guerre, il n’y a que des mensonges qui poussent les hommes à y partir.
On ne se prépare pas à la guerre.
On fait face, au dernier moment.
[…]
La guerre a commencé.
Des véhicules de police foncent vers le point névralgique de la guerre, là où la bataille s’est engagée. Il en vient de Lille, de Roubaix, de partout. Leurs sirènes rompent le silence nocturne dans un vacarme ahurissant.
« Il y en a un qui a un fusil à pompe ! Il nous a fait feu. Ils sont en face, je sais pas. C’est la panique, là… »
Dans la 405 de la PJ qui fonce à tombeau ouvert, le capitaine Joël Attia et le lieutenant Riva Hocq sont muets. Les yeux écarquillés, ils sont hypnotisés par la voix de leur collègue, le major Cardon, sur la bande passante. Ils sont entrainés, ils sont armés, mais ils n’ont jamais imaginé partir à la guerre. Jusqu’à cette minute.
[…]
La guerre dans la banlieue de Roubaix, comment pouvait-on prévoir ?
Le gang de Roubaix
Dans la réalité, et dans le roman, il s’agit de ce que l’on a appelé le Gang de Roubaix.
Brutalement sorti de son lit qu’il partage avec une rencontre de hasard, une jeune fille encore mineure et couverte de cicatrices, encore embrumé par la coke, le journaliste Réif Arno, (Arnotovic de son véritable patronyme) part en reportage sur ordre de son patron. Le gang a de nouveau frappé. Spécialiste des attaques de supérettes, il a encore sévi à Croix, semant sa route de morts et se remplissant les poches de son butin. L’argent, le nerf de la guerre… Réif, comme tout le monde, pense à une affaire de grand banditisme. Le gang n’en est pas à sa première attaque. Le journaliste cherche à en savoir plus, grâce à un de ses indics, un certain Ben Arfa, videur de son métier.
C’est Allah qui les intéresse
- Tes mecs, là, qui ont flingué les keufs, ils ne sont pas du milieu, dit le truand en s’engageant sur l’E17 en direction de Gand. Ils ont d’autres idées : le fric, ce n’est pas pour ça (il montre la Rolex) ou pour mener la belle vie.
[…]
- C’est qui, ces mecs ?
- Des types qui reviennent de Yougoslavie.
Arno tire une bouffée sur sa cigarette et la recrache lentement, pour ne pas montrer son étonnement. Puis :
- Des Serbes ? Des Bosniaques ? Ils viennent braquer en France ?
Ben Arfa éclate de rire.
- Ils sont plus français que moi, tes Bosniaques ! Et que toi… Arnotovic.
[…]
- Tu ferais bien de te méfier de ces mecs. Je te répète que c’est pas les belles bagnoles ou les gonzesses qui les intéressent.
- Qu’est-ce qui les intéresse ?
- Putain ! mais t’es con ou quoi ? C’est Allah qui les intéresse. Ils ramassent du fric pour mener le djihad.
Arno en reste bouche bée.
- Le djihad, ici, en France ? Comme Kelkal ?
- J’en sais rien – et je m’en fous, pour tout dire. Ces gars, je m’en méfie, on s’en méfie tous : ils sont en guerre.
Une guerre ?
La troisième guerre mondiale ? Comment l’Histoire relira-t-elle l’implantation, dans une bonne partie du monde, d’un islam guerrier, bien décidé à pourfendre toutes celles et tous ceux qui ne marchent pas dans leurs pas ? Ne peut-on pas faire des parallèles entre la résistible ascension d’Hitler, et celle de Ben Laden et de ses successeurs ? Une ascension commencée par les Frères Musulmans de l’Égypte des années 30, sous l’impulsion d’Hassan el-Banna, grand-père de Tariq Ramadan… ?
Dans cette chronique, nous suivrons tout particulièrement le journaliste Réif Arno, embarqué malgré lui par le flot tumultueux de l’Histoire et de l’histoire contée par Frédéric Paulin.
Ingrédients romanesques obligent, il se trouve que Vanessa, (la jeune fille aux cicatrices avec qui il a une aventure sexuelle, qui deviendra une aventure amoureuse), est la fille de Tedj Benlazar. Benlazar, agent de la DGSE, est toujours en avance sur la compréhension de ce qui se passe. Lucide, mais pas écouté par sa hiérarchie. Il avait prévu, dans La guerre est une ruse, que ce lien contre nature entre militaires et islamistes engendrera inévitablement le grand bordel. Le grand bordel, comprendra l’importation des problèmes algériens en France.
Des français appartiennent à la brigade El Moudjahidin
Presque 10 ans plus tard, Benlazar se trouve à Sarajevo, où il a pour mission de surveiller le bataillon des volontaires islamistes internationaux, basés dans la ville de Zenica. Des habitants lui ont assuré que des Français appartenaient à la brigade El Moudjahidin. Un ancien de la brigade, moyennant quelques dollars, a balancé des noms. Benlazar a établi et transmis à la Boite des « fiches blanches ». Ces fiches de signalisation sont au nom de Lionel Dumont, Mouloud Bouguelane et Christophe Caze.
Des noms que l’informateur du journaliste Réif Arno lui a lâchés, avant de l’abandonner sur l’autoroute et de l’assommer d’un méchant coup de crosse.
Réif vient de faire ses premiers pas sur la route d’une longue aventure, route sur laquelle il va risquer d’y laisser sa peau. En réalité, il est un pion dans une partie d’échecs dont il ne maîtrise rien, tout en croyant parfois le contraire. Et c’est, entre-autre, ce qui fait de lui un personnage attachant, intéressant. Un personnage qui fait aussi se poser la question de l’indépendance de la presse dans ce type de situation. Qui manipule qui ? Qui informe, ou désinforme qui ?
En France et dans le roman, on assiste aussi à la radicalisation de Zacarias Moussaoui. Ou comment, en République, en démocratie, on peut favoriser la fabrication d’un djihadiste, sans rien y voir. Tiens, il a beau être diplômé (un BTS technico-commercial obtenu au lycée Louis-Arago, à Perpignan, et un diplôme de commerce international de l’Université de South Bank, à Londres), son nom en haut de son curriculum vitae rebute les employeurs. Jamais il n’a obtenu d’entretien d’embauche pour un travail intéressant. […] Oui, aujourd’hui il est fier de sa barbe, de ses idées, de sa rigueur religieuse et des mots qu’il a employés contre sa sœur. S’il n’y avait pas eu les frères de Finsbury et de Baker Street, à Londres, et ceux de Khaldan, en Afghanistan, il se serait sûrement donné la mort. Heureusement, avec eux, il a appris à être meilleur. Grâce à eux, un jour, le monde entier l’entendra.
L’Afghanistan, c’est là que se retrouve Réif Arno, pour de longs mois, prisonnier dans un camp dans les zones tribales entre l’Afghanistan et le Pakistan. Sa vie a basculé. De petit journaliste de province, il fait quasiment figure de reporter de guerre. Une situation pour laquelle il n’est pas vraiment taillé.
Réif Arno remonte à la surface d’une eau sale, collante, qui sent la sueur. Il n’est pas mort, mais son cerveau semble battre sous son crâne. La douleur lui transperce la tête d’une tempe à l’autre.
Il est allongé sur une couverture à même le sol, dans une pièce quasi obscure. Un homme est assis en tailleur devant lui.
- L’ascension a été trop rapide pour toi, mais ça ira. Le mal des montagnes, peu de gens y échappent, à cette altitude.
Arno réussit à s’asseoir.
- Tiens, avale ça, dit l’homme en lui tendant un cachet et un verre d’eau.
Il sourit dans sa barbe, il ne doit pas avoir plus de trente ans, porte une sacoche noire à l’épaule.
- C’est de l’acétazolamide, contre le mal des montagnes.
[…]
- Tu es français ?
L’homme ne répond pas. Français, peut-être ; éduqué, certainement : il parle un français impeccable et sans accent.
- C’est le Pakistan ou l’Afghanistan, ici ? demande Arno.
L’homme ferme les yeux.
- Ici, ce n’est ni Islamabad ni Kaboul. On est ailleurs.
Il dépose sa sacoche et s’assoit sur l’un des bancs qui bordent la cour. Arno l’imite. Un instant plus tard, Ahmad Khan Zazaï apparait au portail. Qasim Abdullah le suit, il sourit au journaliste.
- Ah, you look better, French journalist, lance-t-il.
Quant à l’homme qui parle français, il a oublié sa sacoche, dans laquelle Arno trouve une enveloppe, avec une adresse à Narbonne. Et le nom d’une femme, Aïcha Moussaoui.
[…]
Tora Bora, l’antre du diable
Au bout d’un temps qu’Arno est incapable de quantifier, les ânes grimpent sur une route plus large.
L’homme pointe son index vers une montagne dépouillée de toute végétation, dont le sommet est caché par une brume grise.
- Tora Bora !
[…]
Tora Bora, c’est quelque chose comme l’antre du diable – pourtant, une certaine excitation le saisit : est-il possible que lui, petit fait-diversier d’un quotidien du nord de la France, puisse rencontrer Oussama ben Laden en personne ? Il va tenir le coup, il va s’en sortir indemne et revenir en France. Et là, oui, on va lui cirer les pompes et lui lécher le cul avec de grands sourires quand il rentrera à Paris.
Zacarias, lui, le jeune français, déchante un peu mais se tient prêt à exécuter ce pour quoi on le formate. Il s’appelle maintenant Abu Khalid al Sahrawi. Tora Bora n’a rien à voir avec ce qu’on en dit. Zacarias croyait à cette histoire de forteresse enterrée plusieurs centaines de mètres sous terre, à ses équipements modernes, sa clinique, son arsenal contenant de quoi armer des milliers de combattants, son char soviétique.
En réalité, c’est plutôt un réseau de grottes sommairement aménagées. Certaines sont plus confortables que d’autres, c’est là que vivent les dirigeants d’Al-Qaïda. Lui, la nuit, il grelotte dans une petite grotte moite et à peine éclairée qu’il occupe avec six autres combattants. Le jour, il apprend : beaucoup d’exercices physiques, quelques entrainements au tir et la lecture du Coran. Parfois il voit passer le chef, Oussama ben Laden, appuyé sur une canne et souriant.
[…]
Il lui a demandé s’il se sentait prêt
Récemment, Khalid Cheik Mohammed est venu le voir : il lui a demandé s’il avait un passeport français, s’il se sentait prêt. Khalid Cheik Mohammed est un des principaux chefs d’Al-Qaïda, il a déjà attaqué les États-Unis : l’attentat contre le World Trade Center en 1993, il parait que c’est lui qui l’a organisé. Zacarias a compris que lui aussi serait bientôt envoyé quelque part, pour accomplir son grand destin.
Un truc énorme
Le journaliste Réïf Arno, après de longs mois de captivité pendant lesquels, chaque jeudi, un érudit est venu s’entretenir avec lui, est enfin libéré. Retour en France difficile à organiser.
Il faut pourtant qu’il rentre en France rapidement. Il le faut, car il la tient, son interview. Bien sûr, ce n’est pas celle qu’il espérait, celle d’Oussama ben Laden, mais un de ses lieutenants proches a accepté qu’il enregistre ses propos. Arno n’en revient toujours pas : si l’homme dit vrai, il tient un scoop de première classe. Un truc énorme qui pourrait lui valoir beaucoup plus que des coups de fouets, ici.
La barbe d’Arno a poussé durant ses longs mois d’isolement, et il est coiffé d’un pakol que lui a offert le vieux Salem au début de l’hiver, mais il est vêtu à l’occidentale : les regards méfiants de certains hommes dans la rue le lui rappellent.
[…]
Une pieuvre insaisissable qui grandit en permanence
Comme à tous ses collègues, comme à tous les flics et agents des officines de renseignements, on a ordonné à Fell d’être prête à se battre. Mais contre quoi, contre qui ? se demande-t-elle sans cesse. Plus elle fouille, plus elle se rend compte qu’Al-Qaïda est une pieuvre insaisissable qui grandit en permanence. Alors elle bosse, elle se familiarise avec cette nébuleuse, elle apprend les noms, les pseudonymes, les dates, elle relie des éléments, des faits, des déclarations. Ce qu’elle commence à savoir d’Al-Qaïda est fragile et mène souvent à des impasses, mais elle se constitue une véritable connaissance de l’organisation. C’est son boulot.
Elle se demande aussi où est passé Benlazar, une fois de plus en délicatesse avec ses employeurs de la DGSE.
Puis, le 7 août, Al-Qaïda donne le coup d’envoi d’un autre match : le terrorisme à grande échelle. À 11 heures, Fell décroche son téléphone. Le lieutenant-colonel Chevallier de la DGSE l’informe que le Kenya et la Tanzanie viennent d’être simultanément touchés par des attentats. « C’est énorme » répète-t-il plusieurs fois. Des voitures piégées ont explosé devant les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es-Salaam. Plusieurs immeubles se sont écroulés. On compte des centaines de morts et des milliers de blessés.
[…]
Puis, un matin, on frappe à sa porte.
[…]
Je fais quoi de ça, moi ? Qui va croire un truc pareil ?
Il se laisse tomber dans l’un des deux fauteuils devant le bureau du commandant de la DST. Il a l’air épuisé, un peu nerveux.
- Vous êtes qui, exactement ? l’interroge Fell sans masquer son scepticisme.
- Réif Arno, je suis journaliste.
[…]
Réif raconte le camp, les rencontres…
Le journaliste n’a pas l’air d’un illuminé, mais les dingues cachent parfois bien leur jeu. Tellement bien qu’eux-mêmes ignorent qu’ils sont porteurs de vérité.
- Khalid Cheik Mohammed est devenu plus ambitieux, reprend Arno. Et après ce qu’à réussi Al-Qaïda à Nairobi et à Dar es-Salaam, il peut se le permettre. Son nouveau plan, c’est une dizaine d’avions qui iraient s’écraser sur des cibles aux États-Unis.
Je fais quoi de ça, moi ? Qui va croire un truc pareil ?
Fell a du mal à cacher son trouble. Elle joue maladroitement avec un petit bloc de Post-it qui finit par terre.
- Quelles cibles ?
- Le World Trade Center, de nouveau, mais aussi le Pentagone, le QG de la CIA, celui du FBI. Et des centrales nucléaires, des buildings à Los Angeles, à Washington et à New-York.
[…]
- Pourquoi il vous a dit tout ça ?
Le journaliste dévisage la flic quelques secondes.
- Je ne sais pas. Peut-être par vantardise ? Parce qu’il croyait qu’on allait m’empêcher de repartir ? Qu’on allait me tuer ?
Ou parce qu’il t’a raconté des conneries, simplement, pense Fell.
[…]
Le 11 septembre 2001, une journée pas comme les autres
Le 11 septembre 2001 semblait pourtant être une journée comme les autres.
Laureline Fell a retrouvé Benlazar, dans un bar. Elle le quitte pour aller aux toilettes. Quand elle revient dans la salle…
[…]
Tedj Benlazar apparait devant elle. Son visage est blême. Son index est pointé vers la salle où la télé gueule à présent. Elle entend « World Trade Center », elle entend « avions », elle entend « acte de guerre, elle entend « milliers de morts », elle entend des mots qui la font frissonner, les yeux fixés sur les lèvres de Benlazar qui tremblent sans prononcer un mot.
- Tedj, qu’est-ce qu’est-ce qui se passe ? C’est la guerre ?
- Ce n’est que le commencement, je crois. Les prémices…
En Pennsylvanie, 10heures (16 heures, heure française)
[…]
- Allah est grand ! Allah est grand ! scandent les terroristes.
Le Boeing 757 s’écrase dans un champ, à 120 kilomètres de Pittsburg.
Grâce à l’héroïsme des passagers qui ont sacrifié leurs vies, les terroristes n’atteindront pas leur cible, le Capitole.