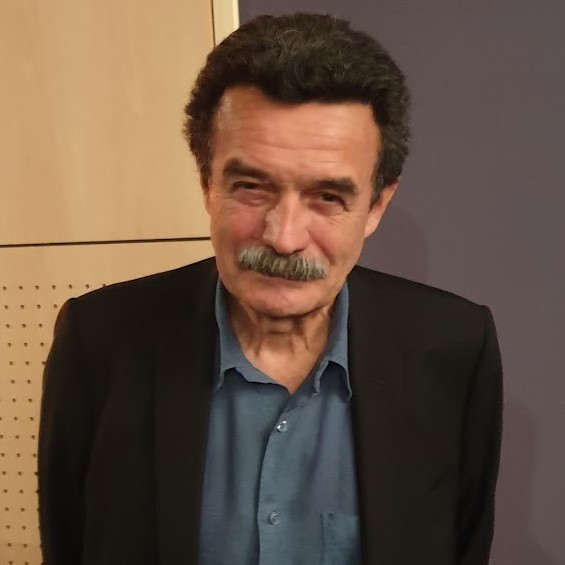Elle sait que ça va tomber, insultes ou gifles ou… Elle ne sait pas quand mais elle sait que, malgré toutes les précautions qu’elle prendra, ça tombera. Elle sait qu’elle aura beau se rétrécir, se recroqueviller dans le silence et la discrétion jusqu’à acquiescer à toutes ses demandes, il la punira pour sa docilité dont le manque de caractère l’exaspérera de la même manière qu’il punira son audace si elle ose s’opposer à lui par des objections qui lui déplairont et auxquelles il répondra par des gifles ou en lui serrant la bouche entre la presse de ses doigts pour qu’elle la ferme enfin, parce qu’elle ne sait pas ce qu’elle dit et que ça serait bien qu’elle arrête de se croire tout permis ; ou bien qu’elle lui prépare, méticuleusement ; ses plats préférés, elle commettra toujours une erreur sur la quantité de sel ou sur la chaleur, trop forte ou pas assez, de l’assiette, ou sur l’heure du service qui ne sera jamais satisfaisante parce qu’elle arrivera toujours au mauvais moment, en plein milieu d’une émission ou d’un bricolage dont il ne supportera pas l’interruption, bien qu’elle ait étudié, depuis le temps que les raclées ont commencé à tomber ou que les litanies d’injures ont débuté leur flétrissure, ses habitudes afin de savoir exactement l’heure à laquelle il serait satisfait qu’elle lui serve le repas sans qu’elle y arrive jamais parce que ça n’est presque jamais le bon moment – pourtant elle persiste, chaque soir, à essayer, malgré cette quasi-certitude de l’échec, de trouver l’heure exacte, pari dont elle éprouvera une bête fierté lorsque, si rarement, - ça a dû arriver quatre ou cinq fois en six ans – elle proposera de passer à table pile à l’heure de son envie et que sans qu’il l’en félicite – il ne le fait jamais ou alors de manière ironique- l’absence de remarques ou de coups ou d’insultes marquera l’approbation satisfaite de son compagnon – oui, c’est ça, compagnon, pour la dernière syllabe, pense-t-elle avec amertume. Alors, elle guette fébrile, à l’oreille, le moindre de ses gestes, au moins pour prévenir son arrivée. Il est dans le salon. Il y a de la musique, elle ne sait pas ce qu’il fait.
Penchée sur l’évier, elle fait la vaisselle, les épaules remontées sur la nuque pour parer le coup inattendu – c’en est devenu une telle habitude qu’elle ne parvient plus à desserrer les épaules et qu’elle se déplace ainsi, femme sans cou, raccourcie, malgré les conseils du médecin qui a constaté les contractures de son dos qu’aucun médicament n’a réussi à assouplir et dont il la prévient qu’elle en aura des séquelles plus tard si elle ne parvient pas à se détendre. Le repas s’est bien passé, presque aucune remarque. Il souriait même. Surement cette nuit, elle y passerait, et, à cette pensée, instinctivement, elle frissonne et ses cuisses se crispent et se resserrent. Mais, pour l’heure, cette bonne humeur, anormale, l’affole et ses mains tremblent. Elle ne cesse de jeter des regards en arrière tandis qu’elle nettoie, sans les voir, sous la mousse, les couverts, dont le couteau à viande, qui lui glisse des doigts, si aiguisée qu’il lui coupe la paume. Elle parvient à réprimer le cri de douleur qui la saisit et qui l’exaspèrerait s’il l’entendait, mais pas le sursaut de surprise qui lui fait bousculer l'étendoir à assiettes dont l'une, mal équilibrée, se détache, tombe – elle la regarde tomber sans pouvoir rien faire pour empêcher son éclatement certain dont le vacarme, elle le sait déjà, va entraîner ...- et s'étoile au sol.
- Putain, j'en étais sûr, mais c'est pas possible ; tu le fais exprès.
Elle s'empressait de ramasser les morceaux, il n'avait pas réagi, peut-être était-il monté dans la salle de bain ou descendu à la cave, elle n'avait que quelques secondes. Mais non. Il avait tout entendu. Simplement il s'était levé sans bruit, était rentré silencieusement, exprès pour lui faire peur avant de... Il n'avait pas hurlé sa colère, il avait dit la phrase froidement et c'était tombé.
Elle se relève, elle a mal aux hanches, au bas ventre. Il est tard. Allongé, il ne bouge pas. Elle va dans la salle de bain, prend une douche, se lave, se nettoie profondément. Puis elle s’empresse, furtive, ouvre une valise : quelques vêtements, une trousse de toilettes… prend ses papiers, un peu d’argent. Depuis minuit, c’est la fin du confinement. Elle peut désormais sortir et s’enfuir. Dans le Sud, elle y a de la famille.
Dans la nuit, il l'a prise. Elle lui a résisté : « Allez, tu veux pas te faire pardonner ? » Il l'avait jetée sur le divan et l'avait pénétrée. Elle s'était débattue. Il était lourd, tout son poids sur elle, sa bouche soufflant dans son cou ; il lui serrait un bras et, dès qu'elle bougeait, il le lui tordait, presque à le casser. Mais, au moment où il allait jouir, il s'était relâché, elle n'aurait pas supporté de recevoir une fois de plus, en elle, … La nausée décupla ses forces. Elle le frappa au visage, le repoussa de tout son corps. Il tomba en arrière, sa tête heurta l'angle de la table ; il s'étala au sol, évanoui. Du sang poissait sa nuque et l'arrière de son crâne. Elle ne s'était pas affolée. Il fallait juste qu'elle parte. Elle a vérifié les horaires des premiers RER sur internet et a attendu. Elle allait le voir de temps en temps. Il demeurait inerte.
4h00. Elle s’en va. Elle referme la porte. Dans la rue, elle marche vite. Maintenant qu’elle ne le voit plus, elle a peur. Elle ne peut plus savoir quand il se réveillera, s’il se réveille. Son ombre s’allonge et diminue au rythme des lampadaires. Elle se retourne souvent. Elle calcule : 10 minutes de marche, 45 minutes de RER, l’attente d’un train plus 5 heures de trajet, un dernier bus. Au moins 7 heures avant d’être à l’abri. 7 heures captive encore, liées à d’autres personnes pour la conduire ailleurs.
Elle n’a pas de ticket. La gare est quasiment vide. Elle se rend à l’automate, commande son trajet, fouille son porte-monnaie – elle ne peut pas payer par carte-bleue puisqu’il ne lui en a jamais transmis le code- quelques billets mais presque pas de monnaie. L’écran clignote, dans quelques secondes, l’opération sera annulée. Le temps passe sans qu’elle sache quoi faire, les guichets sont fermés. Elle entend des pas qui dévalent l’escalier, un corps, derrière elle, qui s’approche… Elle suspend ses gestes, ferme les yeux, rentre son cou un peu plus. Il est là, contre elle.
- Pardon, vous avez terminé ? Parce que je suis pressé.
Elle s’écarte, muette, regarde autour d’elle. Il n’y a qu’eux deux. L’homme s’accapare l’automate sans faire attention à elle, retire son carnet.
- Je peux vous en acheter un ?
- Si vous voulez.
Il lui donne un ticket, elle lui tend cinq euros.
- Mais j’ai pas la monnaie.
- ça n’est pas grave, gardez tout, j’ai vraiment besoin de ce ticket.
Le ton est si pressant et implorant que l’homme s’exécute et prend le billet, en lui tendant deux tickets. Elle veut refuser mais il insiste :
- Si, si, prenez-les. Même avec les deux, je vous dois encore de l’argent.
Elle le remercie mais son geste augmente sa nervosité – elle y voit, bien qu’elle ne soit pas superstitieuse et qu’elle sache que les choses adviennent sans ordre ni mesure, ni but, elle ne peut s’empêcher de voir comme une prémonition de sa fuite impossible, de son retour forcé, dans ce deuxième ticket qu’elle fait disparaître dans sa poche puis qu’elle ressort et qu’elle déchire et jette dans la première poubelle bien qu’elle craigne qu’il soit trop tard car la malédiction de ce ticket l’a touchée et que son destin de retour va devoir inéluctablement s’accomplir. Alors son angoisse augmente. Elle n’est plus qu’une vigie affolée dont la tête scrute nerveusement tous les alentours et se retourne sans cesse au moindre bruit ou à la trop longue absence de bruit.
Elle est sur le quai. 7 minutes. Elle ne s’assoit pas car, du quai, on voit l’entrée de la gare et une partie du parking. Elle se cache derrière un poteau et guette. Les premiers flux arrivent. Il est difficile de distinguer quelqu’un mais elle le reconnaîtrait à coup sûr. Ses yeux passent sans cesse de l’entrée de la gare aux rails. « A l’approche. » indique le panneau. Son cœur s’arrête. Elle a cru voir la voiture sur le parking, elle le cherche dans le nouvel afflux qui se presse aux portiques. Est-ce lui, ces cheveux ras… ? Mais la plupart des gens ont des masques. Il avait sa taille, son allure. La rame arrive, lui dissimule l’entrée de la gare. Elle marche vite vers l’avant du train pour s’éloigner de l’embouchure du quai. Les portes s’ouvrent, elle se jette dans le wagon, se cale dans un groupe. Il n’est pas là.
Elle ne le voit pas non plus dans la gare ni dans les wagons.
Lyon, Valence…Le train, sans à coup, poursuit son lent roulis. Elle dodeline, épuisée, s’endort. La voix du contrôleur annonce Marseille. Elle se réveille en sursaut. Il est à côté d’elle. Avant qu’elle réagisse, il lui compresse le genou, à la jointure, entre son pouce et son index.
- Bonjour ma chérie, on va rentrer maintenant.
Elle essaie de se débattre, d’appeler. Un contrôleur arrive. Il se colle à elle, plaque son visage contre le sien. Le contrôleur les dépasse, sourit en regardant la si étroite étreinte. Il lui serre le cou, lui murmure : « A Marseille, demi-tour. On rentre à la maison. On s’expliquera là-bas. »
Le train arrive en gare St Charles. Il attend qu’il n’y ait plus personne dans le wagon. Il la force à se taire le temps que les gens sortent puis à se lever. Il enlace de son bras les épaules de sa femme. Il ajuste son bras pour que la jointure du coude épouse la nuque. Ainsi, il n’aura qu’à contracter ses muscles pour la lui comprimer et bloquer toute fuite. Sa main enveloppe son sein, prête à le pincer.
Ils se dirigent vers le large panneau des affichages. Il la tient si serrée qu’elle ne peut rien faire. Le masque dissimule son visage et ni les policiers qu’elles croisent, ni les voyageurs, ni les employés, personne, ne parvient à lire dans ses yeux. Ils s’arrêtent. Il regarde le panneau puis sa montre. Elle n’aura pas d’autres occasions. Sa montre est sur le bras qui oppresse son sein. Il est obligé de desserrer l’étreinte pour tourner son poignet, et de déprendre la nuque de son épouse. Dès qu’il le fait, Judith se débat, frappe lourdement son pied avec son talon. Se détache de lui. Se libère et s’enfuit. Elle sait qu’il ne peut rien lui faire ici, pas même l’appeler. Il ne peut que la poursuivre. Alors, elle court, fonce à contre sens vers la sortie. Elle court, bouscule les passants, trébuche. Elle se retourne, il est toujours là, derrière, un peu plus loin peut-être, mais elle demeure à sa portée. Alors, elle accélère. Sa fuite brouillonne et bruyante éveille la curiosité dans la gare, l’attention des policiers. Elle court, pousse la porte de bois et de verre qui donne sur l’esplanade. Le soleil l’éblouit. Elle ne voit pas l’enfant devant elle et le percute. Il tombe et pleure. Elle court. Les cris de colère des parents décident les policiers à signaler cette femme qu’ils surveillent depuis deux minutes. Elle continue à courir. Elle s’éloigne de lui. Il craint de la perdre, alors il accélère le pas. Elle bouscule encore d’autres personnes ; en heurtant l’une d’entre elles, le bras de Judith s’accroche à son sac, l’arrache. Le sac tombe et la passante, affolée, hurle qu’on a voulu la voler. Les policiers se précipitent tout en lançant un nouvel appel pour que les autres convergent.
Les voilà sur l’esplanade. Face à elle le muret et, au-delà des toits de tuiles rouges troués de verrières, le brouillard bleu de la mer et du ciel. Elle se retourne et voit, devant elle, la police, à gauche, un vigile, de l’autre côté, son mari.
Elle recule jusqu’au parapet. Les autres se rapprochent. Elle regarde en bas, la fin et le silence. Un des policiers lui demandent de se calmer, lui dit qu’ils ne lui veulent pas de mal, juste essayer de comprendre ce qui lui arrive. Accepter leur proposition ? Et en profiter pour lui échapper et le dénoncer, lui, l’ordure qui la regarde en ce moment même avec des yeux qu’elle connaît trop, de ceux qui, déjà, envisagent le futur huis clos des règlements de compte et les étapes de la punition qu’il pense qu’elle aura méritée, aux flics qui, pour l’instant, l’envisagent seulement comme une voleuse ou une délinquante et non comme une victime et à qui il faudra combien de temps, si elle parvient jamais à les en persuader, pour changer d’avis, pour comprendre que le compagnon, là, qui l’attend dehors ou dans la salle d’attente du commissariat, qui paraît si inoffensif, si attentionné, c’est lui qu’il faut arrêter, c’est de lui qu’elle est victime, que c’est lui qu’elle fuit et qui la viole, combien de temps et d’énergie et de chance lui faudra-t-il pour ne pas qu’ils réagissent comme ceux de la première et seule fois où elle a voulu le dénoncer et qui ont refusé d’admettre qu’un mari pouvait violer sa femme parce qu’il leur était inimaginable que le consentement devant le maire ou le prêtre ne valait pas pour toujours et qu’on pouvait ne pas vouloir, si bien qu’ils avaient accepté une confrontation au bout de laquelle, devant la bonne volonté et les explications du mari, qui avait réduit la situation à une banale dissension momentanée -vous comprenez, un mariage, c’est pas toujours le calme plat - une altercation, un malentendu qui s’était terminé en réconciliation horizontale même si au début elle avait pas voulu, confrontation qui avait abouti aux oubliettes d’un enregistrement sans suite, la main courante des poings qui frappent, avait-elle alors pensé amère et démunie, ces policiers qui l’avaient renvoyée chez elle en lui faisant promettre d’être plus gentille et que ça faisait partie du rôle des épouses, en considérant aussi que les affaires de lit ne concernent pas la justice, que ce sont des affaires privées et non d’emprise et de violence sur l’autre si bien qu’elle était rentrée chez elle et qu’elle l’avait reçue, la raclée, qu’ils avaient niée, suivie d’une pénétration pour lui démontrer qu’en fait, elle aimait ça, si bien aussi que ce jour l’avait murée dans un trou dont elle n’était plus jamais sortie jusqu’à hier, pour en arriver là, à cette impasse, contre le parapet. Les gens s’écartent du périmètre de son encerclement. Certains filment, d’autre s’arrêtent, curieux de la fin de l’histoire.
Les mots du policier se perdent dans les cris des mouettes au-dessus d’elle et de la ville, dans le ciel bleu et froid, balayé de mistral. Elle regarde autour d’elle, puis se retourne. Elle regarde en bas, vingt mètres plus bas. Il suffit juste de fermer les yeux. Elle tombe ou se jette. Sur le goudron, le choc mat de son corps.
On se précipite. Des cris retentissent.
« Terrible drame du déconfinement, titre Le Provençal. Une femme, frappée d’agoraphobie, tombe de l’esplanade de la gare St Charles. Son mari, effondré, se confie à nous. »