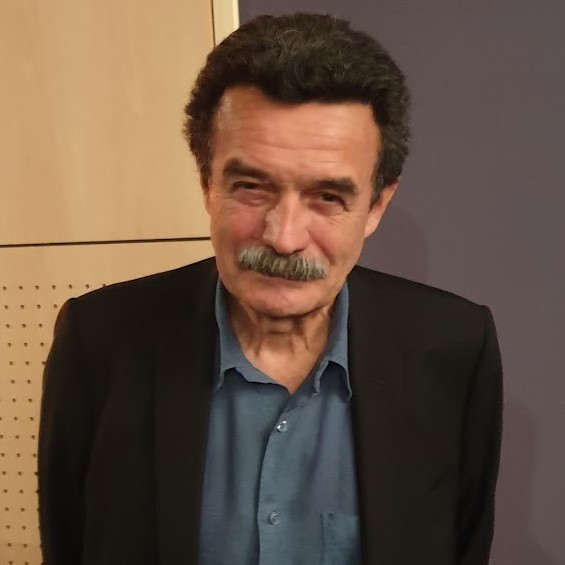Hével. En hébreu tardif : réalité éphémère, illusoire, absurde. Ancien testament, livre de Qohélet.
Nous sommes en 2018, un homme, Gus, raconte à un écrivain, une histoire qui s’est déroulée à la fin des années 50. Acteur et témoin de cette histoire, ainsi que deux autres hommes et une femme, tout particulièrement, Gus se livre à une sorte de confession parfois hargneuse, sans concessions.
En fond de page, la guerre d’Algérie.
Soit, puisque vous y tenez, je vais vous raconter. Mais ce sera comme je l’entends. Quand j’en aurai fini, vous déciderez. Vous prendrez ou vous laisserez. Vous comprenez, tant mieux. Vous ne pigez pas, tant pis.
[…]
Le crime ? Vous êtes tous les mêmes. Ne craignez rien, nous y viendrons. Le crime… C’est la grande question. Caïn, Abel… L’éternel recommencement.
Gus est sans compromis avec l’écrivain qui ne l’impressionne pas. Parfois, il l’engueule. Retiré dans un monastère, il fait le point sur sa vie.
Les moines ne m’ont rien demandé. Ils m’ont donné l’abri, le couvert et la tranquillité. Un lit, trois repas par jour, le silence… Celui d’un monastère est profond. Il en est qu’il oppresse. Vos tumultes intérieurs y donnent de la voix. Ils font cacophonie. Certains fuient pour ne plus les entendre. Mais si vous acceptez leur ramdam, ils finissent par s’épuiser.
[…]
J’ai trouvé ce qui ressemble à une plénitude. La paix ? N’exagérons pas. Ou alors, une toute petite. Une paix de surface. « On vient ici pour trouver Dieu, on rencontre ses propres démons », m’a dit un moine un jour de grande parlure. Je n’ai rien à ajouter. Mes démons ne m’ont pas quitté mais les regarder en face les a apprivoisés.
Aznavour, l'affaire Dominici...
L’action se déroule dans notre région.
L’écriture d’une force impressionnante, sobre, percutante, raconte une époque embrumée par la fumée des Gauloises. On écoute Sur le banc. Un feuilleton tout ce qu’il y a de marrant. Vous ne pouvez pas connaitre. Vous n’étiez pas né. Raymond Souplex et Jane Sourza. Ils jouaient deux clochards, La Hurlette et Carmen, qui en racontent des vertes et des pas mûres. Sur les impôts, le prix du bifteck, la visite du chah d’Iran, la chambre des députés. Des clodos chansonniers, je dirais, pour que vous compreniez.
Grâce aux postes de radio, ou grâce à des tourne-disques, on écoute Gilbert Bécaud (le jour ou la pluie viendra). Ou Line Renaud. Ou Une chanson idiote où passaient un vélo, un boa et une fille en partance pour Tahiti.
Charles Aznavour chante qu’« il faut boire jusqu’à l’ivresse, sa jeunesse / Car jamais plus le temps perdu ne nous fait face. »
Il y a aussi l’affaire Dominici, évoquée dans une sorte de feuilleton macabre, par les journaux de l’époque, dont France-soir.
Dans cette France, au-delà des chansons et des réclames de l’époque qu’écoutent les personnages, des gens ordinaires à première lecture, Patrick Pécherot décortique les raisons, et les non raisons de meurtres dus à des emballements que la raison ne contrôle plus, dont un commis par Gus. À Dole. Quartier du Poiset.
Le Poiset. Un coin noir de décrépitude. […] Des aubes froides, des jours crasseux et le soir, la lumière éteinte dans la carrée unique, les étreintes expédiées à la va-comme-je-te-pousse. Un lot ordinaire qui semblait plus miteux encore au Poiset. L’arrivée des Algériens n’avait rien arrangé. Cent cinquante types longs comme des jours sans pain, attifés faut voir comme. L’air de ne pas vous comprendre mais des mots entre eux à vous nouer les nerfs en pelote. Une casbah. Une casbah d’hommes seuls à faire peur.
[…]
Quand on est arrivés, ils se faisaient face. Arabes d’un côté, Français de l’autre. La frontière d’un trottoir entre eux.
[…]
J’étais comme vide. Tuer un homme, c’est quelque chose. Les sentiments, les sensations, tout avait fui. Mon sang même, un froid glaciaire à sa place. Je grelottais à ne plus contrôler mes mains. Vous avez déjà estourbi quelqu’un ?
Patrick Pécherot trace les contours d’une France rurale et ouvrière, une France en proie aux soubresauts de la guerre d’Algérie, une France pour qui le souvenir de la dernière guerre mondiale est très présent, avec ses collabos et ses résistants. La France de la fin des année 50. Il donne matière à réfléchir sur la question des choix que certaines et certains ont eu à faire. Collaborer ou résister. Torturer ou déserter.
Sur les murs, des inscriptions : « Algérie française » « Le FLN hors des usines », « Non à la cinquième colonne ». Des grèves d’ouvriers algériens.
« C’est rapport à la grève » a expliqué le flic, à André et à Gus qui doivent changer d’itinéraire. « Hier, les ouvriers algériens ont débrayé. Aujourd’hui, en retour de manivelle, les Français se croisent les bras. Nous, comme d’habitude, on se gèle les fesses.
Sous un ciel de neige, les fantômes sont revenus...
Bois-les-Lunes, Pupillin, Rouges-Truites, Dole et son quartier du Poiset, lieu d’un meurtre commis par Gus, Morez…
C’est dans un vieux « citron » qu’André et Augustin dit Gus, font des livraisons de diverses denrées inoffensives, qui les conduisent de ville en ville, de bistrots en boui-boui… rejouant à leur façon, Le salaire de la peur.
Il est parfois plus près qu’on pense, le salaire de la peur. Nos cageots, à André et à moi, ne sentaient pas l’aventure. Montbéliard ou Sochaux font moins rêver que Tampico mais on s’y casse aussi bien la gueule.
Au fil du récit, la vie et la place que Gus et André occupent dans l’histoire avec un petit h, et celle avec un grand H, n’est pas si simple qu’il n’y parait à la lecture des premières lignes.
Et tout ce que l’humain recèle de petitesses et de grandeurs, de complexités aussi, va se développer dans ce récit à couper le souffle. Une fois qu’on est embarqué dans le vieux citron, impossible de quitter les personnages.
Je faisais équipe avec André depuis deux ans. Les routes, on en connaissait par cœur les montées, les descentes, les virages et les nids-de-poule. Jusqu’aux platanes, sur les bas-côtés. Les bleds aussi, avec leurs noms lourds de terre, leurs places mortes et leurs rangées de maisons dormantes. L’odeur de renfermé du bahut, la carrosserie brinquebalante, les pneus rechapés, le cliquetis des pistons et la moyenne à tenir.
Un troisième homme, Pierre, va s’imposer dans le vieux Citron et dans l’histoire.
Pierre a perdu la partie. Ceux de sa génération ont perdu la partie. Ils seront à jamais des anciens d’Algérie. Certains témoigneront. D’autres voudront oublier. D’autres encore, s’accrocheront au drapeau comme à une bouée dans un naufrage, l’honneur factice en étendard et la fierté imbécile en médaille.
Sous un ciel de neige, les fantômes sont revenus. Ils sont lambeaux de brume dans les branches, perles de givre sur une toile d’araignée, flocons au vent.
Pierre marche parmi les spectres.
Qu’est-ce qui le pousse à être parti à la recherche d’André ? Il a connu Paul, le frère d’André. Mort en Algérie. Il a quelque chose à dire des conditions de cette mort.
Pierre a toujours son regard las. Comme s’il réalisait qu’un chemin parcouru ne rapproche pas de l’horizon. En dedans, la rouille le ronge.
Il pistait André, à présent il ne se décide pas. Ce qu’il doit accomplir pèse son poids de tourments, une salle d’hôtel ne convient pas. Peut-être devrait-il reculer l’instant. Ou le fuir. Il suffirait de boucler son sac et : salut camarade.
[…]
Il a bu l’eau des puits en cachette, volé des vêtements et de la nourriture. Il a échappé aux soldats et aux rebelles. Il a franchi les cols, traversé la mer, évité les douaniers, les gendarmes et tout ce qui porte un uniforme. Il a longé des granges et des fermes isolées, réveillant des chiens haineux à l’approche des hommes. Il est enfin remonté jusqu’à André. Après tout cela, il se tairait ?
Un jour enfin, il parle.
C’est un flocon qui l’a décidé. Il ne saura jamais pourquoi. Un flocon glissé sous la porte, que la chaleur du poêle fera s’évaporer.
Il a posé la photo sur la table. Une photo de Paul. André s’engourdissait, il reçoit une décharge électrique. Alors Pierre parle. Il dit l’Algérie.
Il y a Simone aussi. Une belle âme. Un des personnages forts du roman.
Elle vagabonde parfois sur les ondes courtes. Elle s’offre un tour du monde. Londres, Rome, Moscou… Les voix venues de loin, les langues impénétrables. Elle y perçoit des élégances anglaises, des clartés latines, des flambées sous la neige. C’est le soir que le voyage opère, les trains de nuit sont les plus beaux. La journée est salle d’attente. Chansonnettes et réclames font passer les heures.
« Y a une pie dans l’poirier, j’entends la Pie qui chante, y a une pie dans l’poirier, j’entends la pie chanter… »
« Leroux, Leroux, c’est la meilleure chicorée. Leroux, Leroux qui donne au café bon goût. »
[…]
Simone rince les bols dans l’évier. Elle regarde ses mains rougies par les vaisselles et les tambouilles. Elles disent les tâches des jours pareils, les aiguilles de l’horloge, les draps où on a dormi et le temps qui fuit.
Actes de bravoure pendant la Résistance, actes barbares liés à la guerre d’Algérie...
Dans ce récit, ponctué par le tictac des horloges comtoises, le temps avance inexorablement vers la vérité de certains actes qui ont été commis. Actes de bravoure pendant la Résistance, actes barbares liés à la guerre d’Algérie.
Les rouages de ce récit (Patrick Pécherot est orfèvre en la matière) ont la minutie de ceux des mécanismes horlogers que les paysans, l’hiver, assemblaient patiemment pour combler les jours et se faire un peu d’argent.
Pour s’occuper la cervelle autant que les mains, les anciens réparaient les tocantes. Petit à petit c’est devenu un vrai boulot. C’est minutieux l’horlogerie. Et économe en moyens. Une table près d’une fenêtre exposée au jour, des outils si mignards qu’on les croirait de poupées, des doigts habiles… Mais ce qui donne la façon, c’est le temps ralenti. Sous d’autres cieux ce serait différent. Le temps pris dans la froidure, c’est lui qui a rendu nos pendules si prisées. Enfin, elles l’étaient encore à l’époque dont je vous parle.
Tout proche du Jura, la Suisse, où va se jouer le dernier acte du drame. En février. Dans le froid. Dans la neige épaisse, d’une forêt tout aussi épaisse. Sous le regard d’un lynx qui apparait, puis disparait… Gus est dans une cabane qui a servi à des passeurs, au temps de la Résistance. Il est à la recherche d’André qui conduit Pierre le déserteur vers la Suisse.
Un autre homme a emprunté les mêmes chemins que les résistants, il se présente à la porte de la cabane.
Ses mains étaient soignées. Des mains de bureaucrate ou de professeur. Celles d’un type capable d’être invité à dîner. Il ne ressemblait pas aux arabes du Poiset. Il faut croire qu’il en existe de plusieurs sortes. […] C’était un arabe à questions, même muettes. […] Elle semblait l’intéresser, ma carte. Soudain, il a porté la main à sa poche. J’ai dégainé mon couteau. Il l’a regardé, surpris, puis il m’a fait signe de baisser la garde. Il a posé son index sur la carte : « Combien pour aller là ? » Son doigt portait une bague à cornaline. Il désignait la Suisse.
L’homme perdu dans la neige hostile s’appelle Adderahmane. Il doit mettre de l’argent en sureté, en Suisse.
Stop ! Vous voilà de nouveau en pleine supputation. Si, si, vous supputez à mort ! Vous ai-je dit que j’avais l’intention d’abattre ? Vous l’ai-je dit ? Non ?
[…]
Mon idée était de le délester à la frontière. De me faire douanier en somme. On le laissait passer, lui, un fella, c’était déjà beau. Mais ses billets, secouez un peu votre matière grise. Les lui laisser, c’était accepter qu’après avoir transité helvétiquement, ils se changent en armes. De rutilants fusils pour allumer nos petits soldats, d’amusants pétards lancés aux terrasses… Vous me voyez porteur de valises ? Et André, vous l’imaginez ?
[…]
Vous trouverez son curriculum vitae sans peine. Parmi les fallas qui opéraient en France, c’était un caïd. Fait aux pattes, tout son réseau risquait de tomber. Le contact qui le véhiculait s’était fait griller. Une étudiante, gentille, jupe plissée, duffle-coat, et, vous le croiriez pas, bien catholique. On avait ça, dans le Jura.
Le ventilateur déplace doucement une mèche...
De l’autre côté de la Méditerranée, bien loin du Jura, l’Algérie et la Tunisie.
La femme repose sur le dos. Sa chevelure cache en partie son visage comme un rideau noir à demi tiré. Elle est nue. Le bras sur sa poitrine semble retenir un souvenir de caresse. L’autre esquisse un geste d’abandon qui aurait inspiré un peintre orientaliste. Gérôme, Tanoux ou Ingres. Un bain maure ou une belle odalisque.
[…]
La femme ne dort pas. Le ventilateur déplace doucement une mèche sur son front et découvre l’œil tuméfié, la pommette ouverte, la bouche saignante. Sous son bras, ses seins se trouent de brûlures qui ont creusé des petits cratères vers l’ineffable.
Sur son ventre, les zébrures violacées des flagellations. À ses chevilles, les anneaux sont ceux de la servitude et de l’horreur électrique. Deux pinces sont fichées dans le triangle de son bas-ventre d’où suinte encore le blanc des profanations.
La belle odalisque est viande.
Nature morte.
Toujours de l’autre côté de la Méditerranée, toujours loin du Jura… mais les faits finiront par être connus…
Le corps est disloqué. Éclaté comme ces fruits trop mûrs abandonnés sur les marchés à l’heure de la remballe. C’est le corps d’un homme mais il ne ressemble plus à un homme. Il ne ressemble plus à rien.
[…]
Avant le grand saut, il a eu le temps de voir la porte d’un Sikorski s’ouvrir sur l’azur, de sentir le vent s’engouffrer dans l’appareil et, sur son mugissement, d’entendre le rire des soldats. Des mains l’ont soulevé du plancher.
[…]
Et le choc indicible. L’éclatement de tout son être. La souffrance fulgurante puis le néant, à jamais refermé sur lui.
Celui qui avait connu les troupes nazies s’inspiraient désormais de leurs méthodes
La guerre d’Algérie, ça a été aussi ce genre d’exactions, qui n’en finissent pas d’empoisonner notre présent.
De bouche à oreille, les histoires résonnent comme ces contes terribles dont l’horreur prend forme à chaque parole. Les premiers corps découverts, la rumeur devenue réalité, la peur se changeait en haine et les bons esprits risquaient de s’émouvoir. Alors les hélicos lâchèrent leurs victimes au- dessus de la mer et la Méditerranée connut ses « crevettes Bigeard ». Celui qui avait connu les troupes nazies s’inspiraient désormais de leurs méthodes. »
La partie adverse n’est pas en reste d’atrocités, elle non plus. Pierre raconte Paul et l’Algérie, Paul en Algérie.
À Pupillin, André ronflait toujours. La somnolence me gagnait. J’ai monté le son de la radio. Les fellaghas n’avaient pas capturé deux mais quatre soldats. Le speaker parlait d’une base arrière en Tunisie où les fells préparaient leurs coups, pépères.
[…]
Paul avait vu le désert, les villes blanches, les caravanes et les chameliers. La riflette aussi. Et de près. Les douars farouches écrasés de soleil où chauffent les idées d’embuscade. Les silhouettes sous la lune et les appels qui se répondent dans la nuit bleue des dunes. Les escarmouches, les attaques éclairs, les rentre-dedans, les razzias et les vautours sur les cadavres. Les bombes aux terrasses. Les copains retrouvés charognes, émasculés, rictus sanglants et couilles en bouche.
[…]
Pierre raconte les hurlements dans la cave. Les tympans qu’on voudrait se boucher, la tête en feu, les vomissures, Paul, livide : « On ne peut pas faire ça ! » Paul, son bégaiement, son air perdu à la réponse : « S’il ne parle pas, tu attends que la bombe pète ? Tu iras regarder les veuves en face ? Les mômes amputés ? »
Pierre parle. Il dit les embuscades, les copains capturés. Égorgés, émasculés, épouvantails pourrissants à la croisée des chemins. Les envies de meurtres, les engueulades, les empoignades. « C’est humain ce qu’ils ont fait ? Tu laisses ça impuni ? On en a déjà châtré des fells, nous ? Tu la voulais, la différence ? Elle est là. Dans la bouche d’Étienne. C’était ton pote, Étienne. Regarde-le ! Mais regarde-le, petit con ! Son sourire kabyle, prend-le en photo, ça fera un souvenir à ses vieux ! »
Et Pierre dit à André comment son frère Paul parti pour fuir un quotidien ennuyeux, a craqué.
Elle est pourrie l’aventure. L’ailleurs pue le cadavre, les chairs décomposées, la putréfaction bourdonnante de mouches.
André n’a pas pipé mot, vieilli, crayeux. Dans sa tête, un petit Paul, des images balançoires et genoux couronnés.
Arrivé en fin de confession, Gus refuse que l’écrivain lui envoie le livre qu’il en aura tiré.
Tout est hével/ Voilà, tout est vain et poursuite du vent/ Rien ne reste sous le soleil, dit l’Ecclésiaste.
[…]
Assassins ? Peut-être le sommes-nous tous. Caïn et Abel, on n’en a pas fini.
Maintenant, allez-vous-en, la nuit va tomber.