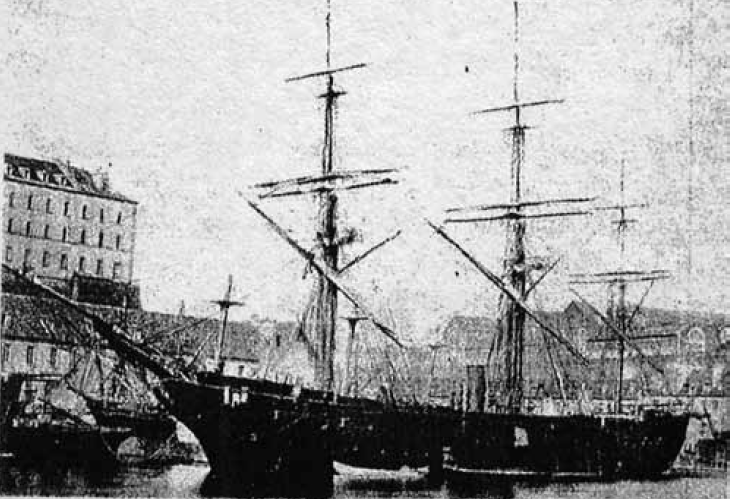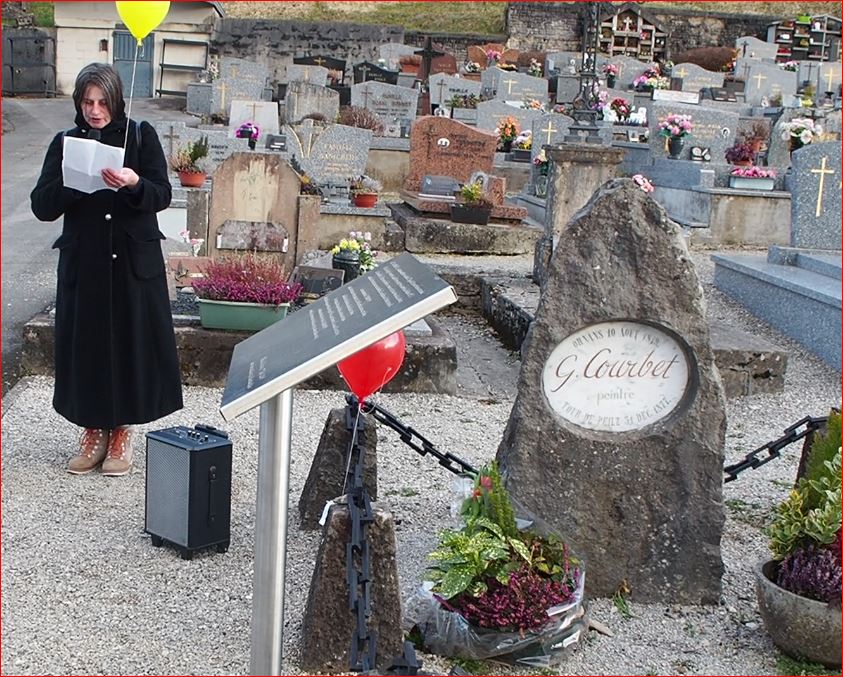Cet article de l'historien François Lassus, a été écrit avec la participation efficace de Jean-Philippe Faille. Comme l'encadré qui suit sur Besançon et la Commune, il a initialement été publié par le Bulletin des Amis de la Maison du peuple et de la mémoire ouvrière de Besançon (n°116, avril 2021).
Il y a quelque temps, Jean-Philippe Faille m’interpellait : — « connais-tu Adrien Nardin : c’est un Communard natif de Voray ? » Ce nom, qu’il a lu dans un bulletin des Amis de la Commune de Paris, ne me disait rien, mais une brève recherche dans les archives du village confirmait la naissance, le 4 septembre 1833, d’Adrien fils de Claude-Louis Nardin, couvreur en bâtiment, et de Claire Marche. Deux filles du couple sont aussi nées à Voray, Catherine en 1831 et une enfant mort-née en 1837. La famille est de Rioz, restant apparemment parfois plusieurs années sur le lieu d’un chantier : en 1844, Claude-Louis est à Neuvelle-lès-Cromary ; un oncle était mort en 1813, déjà à Voray. D’autres démarches, notamment vers des généalogistes, amenaient des informations nouvelles.
La famille de Claude-Louis est installée à Paris vers 1850, dans le 13e arrondissement, rue des Bourguignons (incorporée depuis au boulevard de Port-Royal) : – Claire Marche, la veuve, femme de ménage, décède le 17 mai 1860. – Jean-Pierre, le fils aîné, journalier, s’était marié la même année avec Françoise Choux, également journalière ; le ménage déclare quatre enfants déjà nés : à Rioz en 1846 et 1849, à Paris en 1853 et 1856. – Catherine, la fille, polisseuse, épouse le 10 novembre 1860 Jacques Viellard, journalier ; les conjoints habitent à quelques centaines de mètres de là : c’est apparemment une petite colonie riolaise qui vit dans ce quartier populaire de Paris. — Adrien Nardin, célibataire, est manouvrier (ou manœuvre, journalier) ; il habite avec sa mère.
Il évite l'exécution sommaire...
Comme l’ensemble des membres du groupe familial, il est donc dans cette catégorie professionnelle qui le place vers le bas de la société. Profession sans qualification, exercée au jour le jour sans garantie d’un salaire régulier — classe « dangereuse »... À deux reprises, avant 1870, Adrien Nardin est condamné pour vol. Il se trouve impliqué dans l’insurrection qui secoue la capitale du 18 mars au 28 mai 1871 : la Commune de Paris. Il est engagé dans l’armée de la Commune ; il est arrêté mais, contrairement à beaucoup, évite l’exécution sommaire.
Sa carrière est résumée dans le Dictionnaire du Mouvement ouvrier (le Maitron) à partir des dossiers des Archives nationales et des Archives d’Outre-Mer : « Il avait subi, en 1853 et 1865, deux condamnations à quatre mois et à un an de prison pour vol ; toutefois, les renseignements recueillis sur son compte n’étaient pas mauvais. Il servit au fort de l’Est pendant le 1er siège, comme artilleur de la garde mobile ; licencié le 6 mars, il s’engagea, vers le 1er avril, à la 3e compagnie de marche du 27e bataillon ; le 9 ou le 10, il alla à Neuilly. Vers le 9 mai, il fut envoyé à la porte Bineau où il resta jusqu’au 21 [entrée des Versaillais] ; après une permission de 24 heures, il rejoignit son bataillon le 23 mai à la porte Bineau, puis, ce même jour, regagna son domicile. Il y fut arrêté le 27, puis condamné le 3 mars 1872, par le 9e conseil de guerre, à la déportation simple et à la privation des droits civiques ; il mourut le 26 juin 1876 à l’île des Pins. »
« ... toutefois, les renseignements recueillis sur son compte n’étaient pas mauvais... »
Vers la Nouvelle-Calédonie (in De Paris à Nouméa : l’histoire des insurgés de la Commune de Paris déportés en Nouvelle-Calédonie, éd. Orphie, 2003), Adrien Nardin est « passager » sur le navire militaire l’Orne (aménagé pour le transport des chevaux), le cinquième convoi de déportés : il y est inscrit parmi 450 condamnés à la « déportation simple » et 85 à la « déportation en en- ceinte fortifiée », auxquels s’ajoutent quelques femmes, condamnées de droit commun, accompagnées de deux religieuses. L’équipage est composé de 205 hommes, officiers, personnel de santé et hommes d’équipage. Lors de ses escales à Rochefort et Brest, le navire embarque en outre quinze émigrants, vingt femmes (dont huit épouses de gardiens) et 29 enfants, au titre des passagers libres. Louise Michel fera partie du convoi suivant, fin août 1873, sur le Virginie.
Le récit détaillé ne peut être reproduit ici. L’Orne navigue quatre mois complets, du 1er janvier au 5 mai 1873, emportant près de 550 déportés depuis Roche- fort, Brest, Oléron..., longeant les côtes d’Afrique, avec une escale à l’île de Gorée. Les quelques femmes montées à bord provoquent des heurts chez les hommes de l’équipage. Les gardiens sont nerveux, mais l’un d’eux doit être envoyé aux fers pour avoir manifesté de la sympathie avec les Communards, lesquels n’oublient pas ce pourquoi ils sont là : le 18 mars 1873, jour anniversaire de l’insurrection, les déportés chantent la Marseillaise et le chant des exilés, dans l’indifférence de l’état-major.
Le scorbut et la sous-alimentation se mettent de la partie, et le nombre des malades (sans compter ceux qui deviennent fous ou tentent de se suicider) dépasse 400 à la mi-avril, obligeant à une escale imprévue à Melbourne, où une partie de la population montre un intérêt pour les Communards et la Commune, dont le commandant se serait bien passé : une collecte amasse une belle somme destinée à fournir vêtements et vivres aux prisonniers, mais le bateau change de mouillage pour empêcher l’opération. L’escale à Melbourne ne passe pas inaperçue dans la presse anglo-saxonne.
Le 4 mai, le navire livre les déportés en enceinte fortifiée à Nouméa, et le 9 à l’Île des Pins où le reste des déportés est débarqué en trois jours. Les documents qui ont servi au récit du voyage ne signalent rien sur Adrien Nardin.
Ce sont quelque 2 500 condamnés qui arrivent au bagne de l’Île des Pins en 1872 et 1873, installés dans le tiers le moins fertile de l’île, confisqué aux autochtones, formant cinq communes. La vie des déportés y semble se passer dans une certaine inaction : déportés, ils restent des « hommes libres », assignés à résidence... et beaucoup, comptant sur un prochain retour en France, refusent tout ce qui ressemblerait à une installation définitive, à la création d’une colonie : « Cette liberté apparut très vite comme dangereuse car elle était une prime à l’oisiveté et par suite à l’ivrognerie. » Adrien Nardin meurt à l’hôpital de l’Île des Pins le 26 juin 1876, à 43 ans. On n’en sait pas plus sur la vie et la fin du personnage dans l’île. Il semble avoir été inhumé dans le cimetière du bagne (tombe 130), avec une cérémonie religieuse (il ne figure cependant pas sur la liste des déportés inhumés chrétiennement, tenue par les aumôniers du bagne de l’Île des Pins), et aurait été catalogué comme aliéné (in Jean-Claude estival, La 6e commune : le cimetière des Déportés à l’Île des Pins sort de l’Anonymat, Bulletin de la Société d’Etudes Historiques de Nouvelle-Calédonie, n° 114 (1998-1), p. 39-55). Les tombes sont anonymes : deux seulement sur 230 portent des noms... Le chiffre des morts de la Commune aurait été de 260, ce qui peut paraître faible, mais représente près de 10 % de l’ensemble des déportés. Le bagne a fonctionné jusqu’en 1909 et toutes les sépultures n’ont certainement pas été conservées. Plusieurs sites décrivent ce qui reste aujourd’hui des installations pénitentiaires (ici). A l’entrée du cimetière, un panneau reproduit la déclaration d’un déporté de la Commune, rentré en France lors de l’amnistie de 1879 :
« J’avais 20 ans quand j’ai débarqué, un matin de 1872, dans cette île aux paysages paradisiaques. Je n’ai rien vu de sa beauté, désespéré que j’étais par ma peine, l’exil et la séparation des miens. Beaucoup de mes compagnons, dé- portés comme moi, sont morts sur cette terre. Ce cimetière, au pied de la colline, est leur dernière demeure. Quand, amnistiés, nous avons quitté l’île des Pins, nous avons construit le monument que vous voyez, au centre du cimetière, en es- pérant qu’ainsi nos compagnons ne tomberaient pas tout à fait dans l’oubli. Vous qui passez, songez à ces hommes et à ces femmes qui sont morts ici, loin de chez eux sans avoir revu leur patrie. »
La Commune à Besançon en 1871 ?
« On ne rencontre plus par nos rues que des gendarmes. Nous devons à l’indiscrétion de l’un d’entre eux de connaître le motif de ce foisonnement extraordinaire. Il paraît que le général commandant la division redouterait une émeute de la partie de la population qui s’est toujours signalée par ses votes républicains. »
Le rapprochement est immédiat entre ces mots d’Antonin Fanart (le peintre : 1831-1903) et la chanson de Jean-Baptiste Clément : « Sauf des mouchards et des gendarmes, / On ne voit plus par nos chemins / Que des vieillards tristes en larmes, / Des veuves et des orphelins. »
Mais ce n’est pas à propos de la Semaine Sanglante que ce texte a été publié : on le lit dans Le Doubs du 19 avril 1871 : huit mois après la proclamation de la République (4 septembre 1870), un mois après le déclenchement de la Commune de Paris (18 mars 1871) et un mois avant la répression versaillaise (21 mai).
A Besançon, les républicains auraient-ils été prêts à l’émeute ? Rien n’est moins sûr : le Doubs et la Haute-Saône font partie des « départements occupés par l’armée prussienne où le mouvement communaliste n’a pas pu se développer », indique une plaquette des Amis de la Commune de Paris consacrée aux Communes de province.
Le journal Le Doubs, créé en 1869, est un organe républicain ; à la chute de l’Empire, ses diatribes se portent contre Thiers et les Versaillais Le numéro du 19 avril est le dernier : la suppression du journal est prononcée le 21 avril 1871 (VogNe, La presse... en Franche-Comté..., t. VII, pp. 171-200). Parmi les responsables et rédacteurs, le peintre An- tonin Fanart, le médecin-pamphlétaire Edouard Ordinaire, l’ethnographe Charles Beauquier, l’avocat-journaliste Jules Gros, républicains qui jouèrent tous un rôle dans la politique locale.
François Lassus