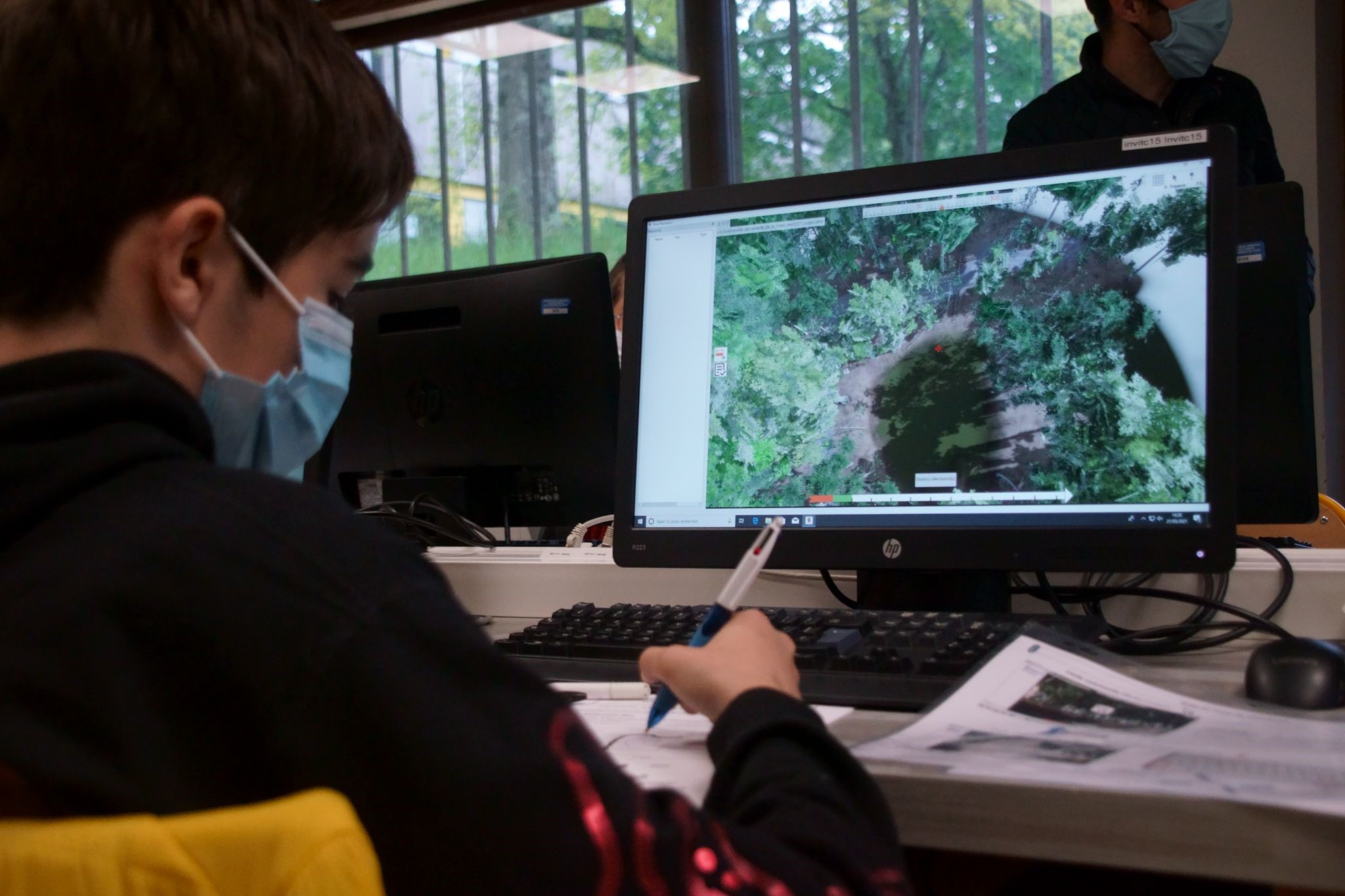Pour son premier jour de boulot au CLA, en 1976, Anne-Marie Stimpfling n'avait pas de travail : «reviens demain», lui dit un collègue. Elle est revenue le lendemain et ne l'a plus quitté. Jusqu'au 17 avril dernier à 17 h 17, moment où elle a payé un pot pour son départ... en congés. Elle écluse les derniers avant de goûter une retraite qu'elle espère aussi active que les quarante dernières années. Elle a démarré 47 rue Mégevand, dans un hôtel particulier où le CLA, créé sous ce nom en 1958 par le lexicologue Bernard Quemada, était installé avant d'emménager à la City en 1992. L'histoire de l'enseignement des langues à Besançon avait commencé en 1899 sous l'appellation d'institut de langue et de civilisation française pour les étudiants étrangers.
«J'avais fait des remplacements au service financier de la fac de lettres, j'étais au chômage... Le principe de recrutement de l'université, à l'époque, c'était de prendre des gens qui connaissaient... J'ai connu la construction du CLA. On accueillait 3 à 4000 étudiants étrangers chaque année dont 6 à 800 l'été, il y avait environ un tiers de Français venant apprendre les langues étrangères. On payait le personnel sur les droits d'inscription, on recrutait des jeunes diplômés - licence ou maîtrise - et des natifs dont certains étaient venus étudier chez nous. Il y avait des contractuels avec des contrats d'un an renouvelable et des vacataires à l'heure. Tous étaient payés sur le budget propre, tous étaient précaires, on allait dans le mur, la fac nous prêtait des locaux...»
Pourquoi était-ce intenable ?
«Les gens voulaient le statut de la fonction publique, être alignés sur les profs du secondaire ou d'université. Il y avait un déficit chronique, on sollicitait régulièrement le ministère, mais le fond du problème, c'était la titularisation des profs et du personnel. On est arrivé en cessation de paiement en 1982, on a été sauv par l'université, présidée alors par Jean-François Robert, qui a mis 250.000 francs sur ses fonds de réserves... Il y avait 5000 manifestants dans la rue...»
Que faisiez-vous ?
«Je participais ! Nos salaires dépendaient de notre lutte... Vers 1985-1988, une quinzaines de profs ont été intégrés comme fonctionnaires et le CLA est devenu un service commun de l'université. 1985, c'est l'année des premiers étudiants chinois, aujourd'hui ils sont 300. C'est aussi un concert de Pascal Mathieu et Maurice Boguet dans la cour du 47... On inventait tout le temps. Le CLA n'est pas seulement un centre de langues, mais aussi de diffusion culturelle, d'accueil des étudiants dans la vie associative et la vie bisontine : il faut le faire tout le temps. On a par exemple développé l'accueil en village, en famille un week-end. Des familles bisontines ont accueilli des étudiants pour une fête, c'est un travail de longue haleine, sans fin, sans fond. On a mis en place des binômes linguistiques pour le perfectionnement. Le milieu associatif bisontin est très accueillant aux étrangers. Quand vous êtes au CLA, vous êtes à l'ONU, vous entendez parler toutes les langues... On a une secrétaire arabophone... Les étudiants étrangers apportent de la culture, des savoir-faire, de la musique, du théâtre...»
Comment en êtes-vous venue à faire de la communication ?
«Les directeurs successifs ont eu besoin d'un secrétariat ! Ils ne pouvaient pas fonctionner avec un secrétariat de stage. C'est comme ça que je suis devenue secrétaire de direction. Ça n'existait pas en 1985 ! La communication n'existait pas ! On s'est interrogé sur le sujet car on devenait concurrentiel avec d'autres centres de langue dont beaucoup de centres privés. On a développé la communication sur un coin de table, sans formation. Avant, on pouvait demander à quelqu'un de réfléchir à un logo, maintenant, ça coûte la peau des fesses... On était des soixante-huitards, on n'avait peur de rien, on travaillait comme des malades. Ce centre était à nous et on voulait le développer. Un été, au début, on a eu tous le même salaire pendant deux mois. C'était l'époque où on communiquait avec la voix et le téléphone. On se voyait souvent...»
Êtes-vous nostalgique ?
«Non. C'était une autre époque. Les réseaux sociaux ont changé la donne... Il reste les relations fortes avec les étudiants, par exemple sur Fukushima. Des associations de solidarité se créent : une étudiante japonaise a fondé une association d'aide internationale à Fukushima. A chaque fois qu'elle passe, elle nous laisse des objets à vendre, elle nous écrit pour dire ce qui se passe... Mon rôle de chargée de relations extérieures consiste à impliquer les étudiants dans la vie de la ville. On a projeté un film sur l'ouverture du lycée de Kaboul qui a ému aux larmes les Afghans qui étaient là. On n'enseigne pas le français à Kaboul comme aux États Unis, les conditions de travail sont différentes. A Kaboul, ce peut être une femme qui enseigne quelques heures, s'occupe de ses enfants, va chercher de l'eau... Au début de la guerre, on avait des professeurs de français afghans, parmi eux un vétérinaire n'avait plus de vaches à soigner : il était fou en voyant celles d'ici...»
Comment sont vécus les interdits alimentaires, le voile, les signes religieux ?
«Au CLA, ça n'a aucune importance, les gens viennent comme ils sont. Les regards diffèrent sur les femmes quand les groupes sont mixtes. Certaines femmes prennent de l'assurance, c'est bien plaisant. Il y a un alignement sur une normalité internationale acceptable par tous».
C'est à dire ?
«Quand on a un groupe de Malaisiennes avec un petit voile de toutes les couleurs, personne n'aurait l'idée de leur demander de l'enlever, ce serait absurde. Des popes grecs viennent en soutane, des religieuses en tenue de religieuses...»
Des tchadors ?
«Peut-être une fois... Certaines femmes algériennes ou marocaines sont très étonnées de voir des femmes voilées dans nos banlieues...»
Y-a-t-il des tensions ?
«Entre Palestiniens et Israéliens, ça se passe bien, il y ont intérêt, ils savent que la France est tolérante. Pour beaucoup d'étudiants africains, la France c'est le paradis : ils sont soignés quand ils sont malades ! Pour eux, il est incroyable que les boursiers français soient soignés...»
Comment le CLA vit-il les accidents ou les conflits ?
«En 2007, il y a eu un séisme catastrophique en Chine. L'association des Chinois a demandé une commémoration, on l'a fait... Dans les relations normales, les gens sont très polis, tout le monde fait attention à ne pas se heurter, les profs sont très doués pour ça. Par exemple, les Japonais sont traditionnellement très discrets, ils n'aiment pas trop la condescendance européenne sur Fukushima, ils disent : on aura la force de s'en sortir... Il y a 80 Mexicains en ce moment, ils sont très heureux... Ceux qui vivent dans un pays en guerre ne se retournent pas sans cesse dans la rue...»