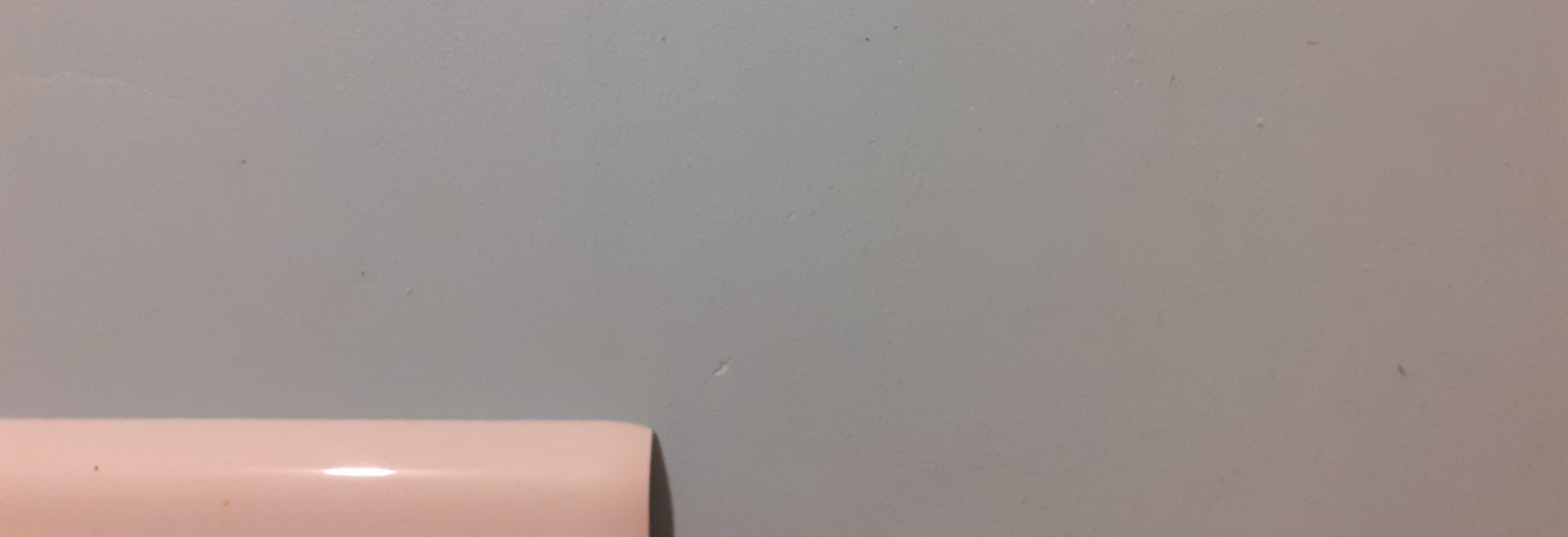Ainsi, j'étais à l’hôpital, installé dans une chambres au CHU Minjoz, derrière une fenêtre qui donnait sur la rue de Dole, la jambe gauche plâtrée de la hanche au coup de pied, gavé d’analgésiques.
Ma seule occupation, lorsque la nuit venait, était de suivre le défilé de phares, de points blancs et rouges, de gyrophares, qui roulaient sur la grande voie, de suivre à l'oreille le chariot de l'infirmière de garde sur le lino pendant sa tournée.
Parfois, la nuit, une femme pleurait. Quelque part, pas très loin de moi, comme un chat, en petits morceaux. J'imaginais ses larmes cristallines tomber sur les barres en inox de son lit médicalisé et se répandre sur le sol comme un tapis de billes, et venir s'étendre dans tout l'étage.
Et pourquoi pas, descendre en cascade dans les escaliers faiblement éclairés, tomber droites dans les cages des ascenseurs, sortir enfin sur le parvis, au milieu des fumeurs.
Au matin, avec les aides soignantes, les infirmiers, infirmières, les médecins, les employés du ménages, nous comparions nos cernes. Moi j'avais de la chance, puisque je pouvais dormir la journée. Je crois qu'ils avaient peur pour mon cœur, pour mes constantes, comme on dit dans les séries télé.
Les bleus sur le coté s'estompaient. Je le sentais en passant ma main que la chair n’était plus douloureuse, sensible, que les cicatrices de ma peau s’adoucissaient.
Ma compagne venait me rendait souvent visite, mes enfants aussi, m'apportant des livres et des chocolats et des fruits. Je gardais les chocolats et les fruits mais leur redonnais les livres, car je voulais profiter de ce moment pour en finir avec cette addiction.
Le dernier jour, je partis avec un aide soignant pour faire une radio, afin de contrôler si mes os vieillissants avaient bien pu commencer à se ressouder. C’était un nouveau, un novice, avec un tatouage d'arbre sur l'avant bras, et il s'est perdu dans les couloirs du sous sol. Il s'arrêtait à chaque intersection, après chaque double porte, pour essayer de repérer. Je finis par lui sourire, histoire de lui faire comprendre que je ne lui en voulais pas. Il me rendit mon sourire en haussant des épaules puis finit par s'arrêter dans un service pour demander son chemin.
Nous rentrâmes au hasard dans le premier venu et il se mit en quête d'un soignant pas trop débordé.
Je jetai un coup d’œil. Nous étions au sous sol. Des boxes vitrés à mi hauteur s’alignaient le long d'un mur à moitié enterré, avec des fenêtres allongées comme des soupiraux. Je me doutais que les femmes et les hommes présents étaient en thérapie anti cancer, car ils étaient tous chauves ou le front ceint d'écharpes. Je poussai mon fauteuil roulant de quelques mètres.
Un homme d'une soixantaine d'année était allongé dans un lit, sanglé par des bandes de cuir peintes en blanc. Il tourna la tête, je devinai qu'il devait souffrir d'une tumeur au cerveau, car un large pansement ornait le coté de sa tête, et son regard s'arrêta sur moi, ni suppliant ni colérique. Il tira légèrement sur ses liens, fit un geste de la tête. Il semblait me dire « je veux partir, je ne veux pas finir comme ça, pas ici, aidez moi ». Une femme, sans doute sa compagne, passa devant moi, s'approcha de lui et mon infirmier revint, un papier à la main.
« C'est bon, me déclara-t'il je sais où aller ».
J'eus envie de lui dire que le monsieur là bas, dans son lit, aussi il savait maintenant où il allait, qu'il n'avait pas besoin de papier, juste de confiance et d'amour. Je restai silencieux, le regard bleu gris de l'homme flottant dans ma mémoire.
Dans la salle d'attente de la radio, tandis que mon aide soignant se faisait doucement engueuler pour le retard, je roulai mon fauteuil jusqu'à une étagère garnie de livres, en saisit un au hasard et le glissai dans mon fauteuil, entre ma cuisse valide et l'accoudoir. Je commençais à m'éloigner, puis me ravisai.
Je revins vers l’étagère, en saisis un autre pour la femme aux pleurs de chat.